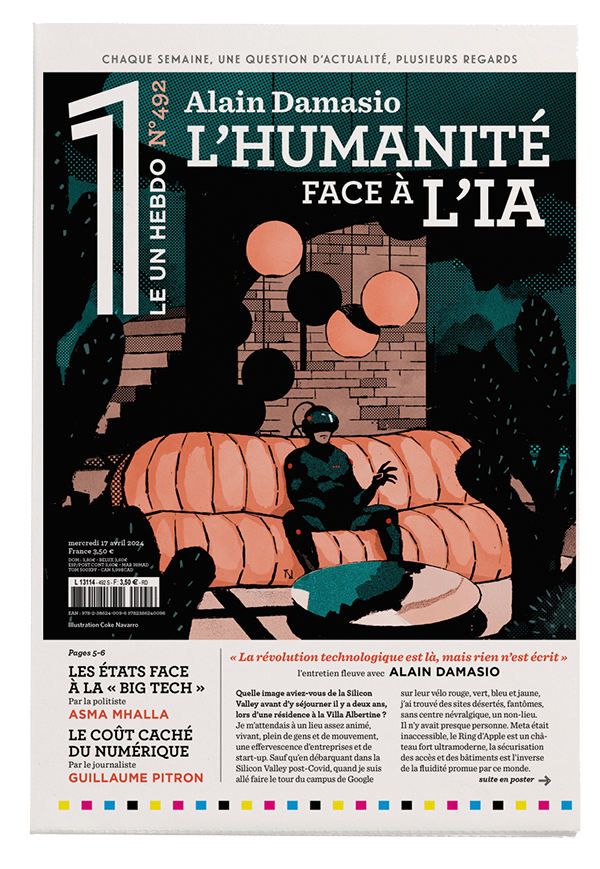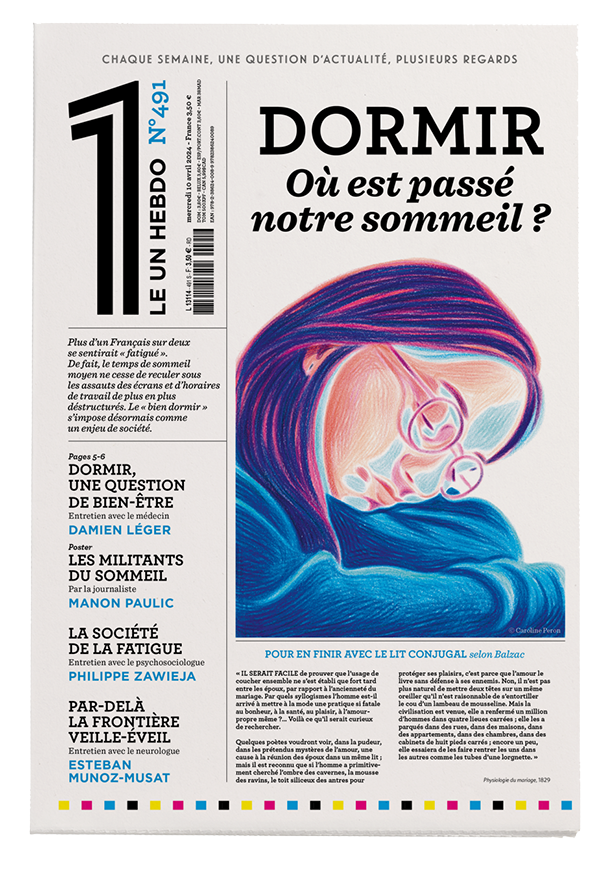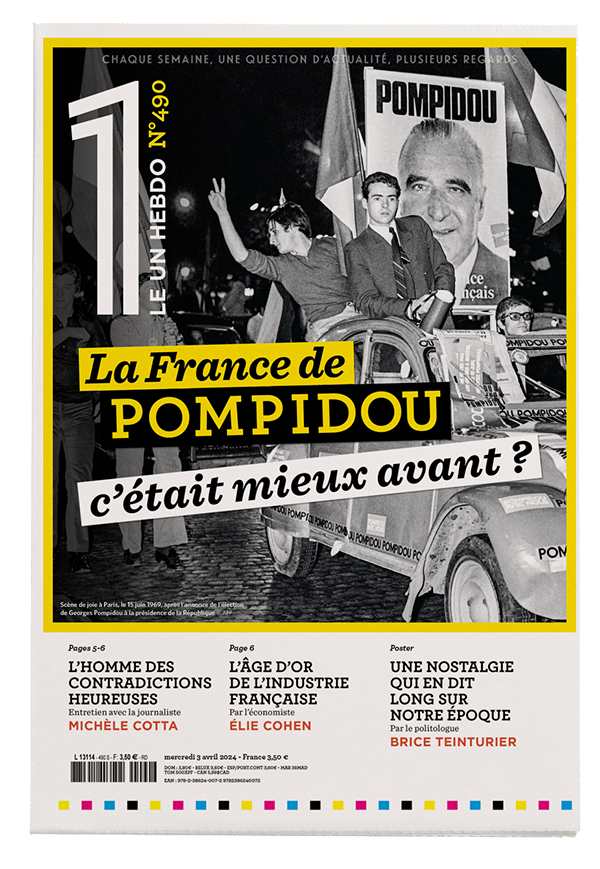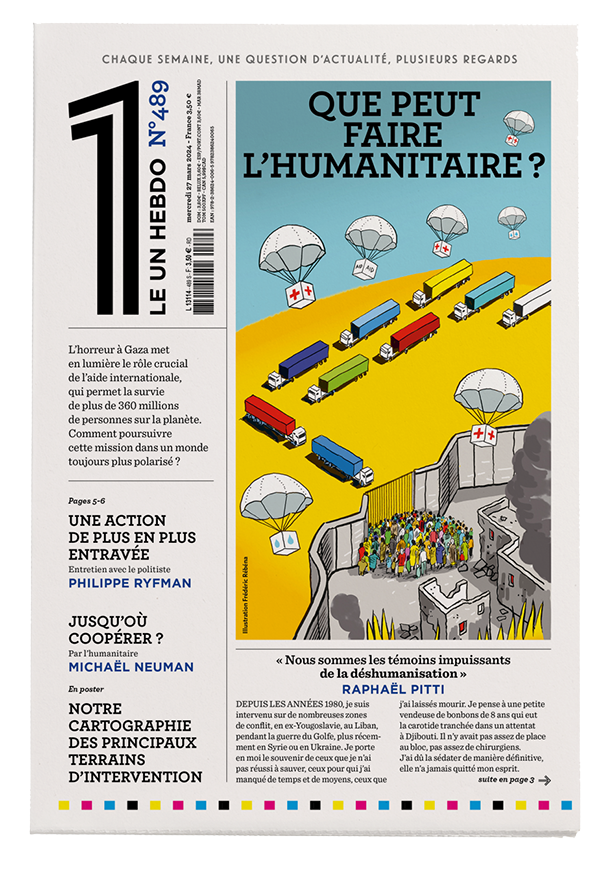1950-2020 : le Grand Satan et le diable iranien, une politique de coups tordus
Temps de lecture : 21 minutes
En cette fin novembre 1943, pour la première fois, l’Américain Franklin Roosevelt, le Soviétique Joseph Staline et le Britannique Winston Churchill se rencontrent pour parler de l’avenir. Les Alliés pressentent déjà que la Seconde Guerre mondiale se terminera par leur victoire. Ils se retrouvent à Téhéran. Pourquoi ce lieu ? C’est Staline qui l’a choisi. Le maître de l’URSS veut un endroit sûr et proche de ses frontières. C’est le cas de l’Iran, qui a proclamé sa neutralité dans le conflit mondial, avant de déclarer la guerre à l’Allemagne au mois de septembre précédent. L’Iran que Britanniques et Soviétiques ont conjointement envahi en 1941 pour déposer son monarque, Reza Shah, qu’ils soupçonnent de sympathies pour l’Axe, l’alliance germano-italo-nipponne.
Les trois dirigeants n’entretiennent pas les mêmes relations avec l’Iran. Par le biais de l’Anglo-Iranian Oil Company (AOIC), le Royaume-Uni y dispose de positions pétrolières outrageusement dominantes. Londres s’intéresse de surcroît à l’Iran parce qu’il jouxte l’Irak, alors sous mandat britannique et qu’il maîtrise une des rives du golfe Arabo-Persique. L’URSS, de son côté, y jouit du soutien du Parti communiste, influent dans les milieux intellectuels, et parmi les Azéris et les Kurdes, deux importantes minorités en Iran. À cette époque, en revanche, les États-Unis ne s’intéressent pas encore à ce pays. Leur unique point d’appui au Moyen-Orient est en Arabie saoudite.
Successeur de son père, Mohammad Reza Pahlavi, porté sur le trône par les militaires britanniques et soviétiques, ne peut pas leur refuser grand-chose. Mais, alors que la guerre froide se met en place, opposant l’Est à l’Ouest, le communisme au capitalisme, deux camps alignés sur deux puissances dominantes et détentrices de l’arme nucléaire, les États-Unis et l’Union soviétique, un autre enjeu majeur surgit : la montée en puissance d’un vaste mouvement émancipateur dans les pays dominés par les vieux empires coloniaux, au premier rang desquels figurent la Grande-Bretagne et la France. En Iran, ce mouvement se focalise sur la gestion de la manne pétrolière.
Depuis les années 1920, l’AOIC a imposé à l’Iran « indépendant » des conditions draconiennes d’exploitation de son pétrole, à peine 10 % de la recette revenant au pays producteur. En 1935, un nouvel accord concède 20 à 25 % aux Iraniens. Mais face à un Royaume-Uni qui doit abandonner l’une après l’autre ses colonies, les revendications iraniennes s’affichent. En 1949, les Iraniens exigent de percevoir l’équivalent de ce que les Américains ont concédé à l’Aramco saoudien : la moitié de la recette.
Parmi eux, un homme élève la voix plus fortement. Il se nomme Mohammad Mossadegh (Mirza Mohammad de son vrai nom). Il n’a rien d’un jeune chien fou. À bientôt 70 ans, il est un dignitaire de la monarchie. Il a déjà occupé de hauts postes dans l’administration et au gouvernement royal. Et s’il est conservateur, il est aussi un nationaliste déterminé. Lui et son parti, le Front national, jugent que les Britanniques ont déjà suffisamment joui de l’or noir iranien. Le temps est venu de nationaliser leur société pour en faire profiter la nation. Un lobby probritannique, soutenu par les pétroliers américains, entre alors en action, qui s’y oppose farouchement et menace l’Iran de sanctions, incluant un embargo pétrolier qui mettrait le pays à genoux. Dès cette époque, de possibles sanctions anglo-saxonnes contre l’Iran sont brandies comme une menace potentielle contre sa souveraineté.
Le principe de la nationalisation de l’AOIC est voté en mars 1951 par le Parlement iranien. Un mois après, Mossadegh est nommé Premier ministre par le Shah. Londres et l’AOIC ont déjà indiqué qu’ils s’opposeront à cette nationalisation par tous les moyens. Pour la première fois, Washington intervient directement en Iran, s’affichant comme « médiateur ». Mossadegh va devenir le héros et la victime d’un épisode dramatique qui verra les États-Unis et la Grande-Bretagne, en coordination avec la monarchie Pahlavi, se coaliser pour mener à son renversement.
Dans un premier temps, Londres accepte la nationalisation, mais la négociation bute sur les compensations que l’AOIC exige. À l’été, le Royaume-Uni montre les crocs, envoyant des troupes en Méditerranée et dans le Golfe. L’affaire devient internationale. Mossadegh incarne la résistance aux prédateurs anglo-saxons. Moscou et tout ce que la planète compte de progressistes sont derrière lui. Fin 1951, Mossadegh effectue une tournée très réussie aux États-Unis. Le magazine Time en fait son « homme de l’année ». Mais très vite, le conflit se durcit.
Londres impose aux Iraniens un embargo sur les exportations pétrolières, qui s’effondrent. Dans une atmosphère internationale de guerre froide qui bat son plein, Mossadegh est présenté par les Anglo-Saxons comme « l’homme de Moscou ». Pour conforter son pouvoir, ce vieux politicien conservateur est amené à lancer un vaste programme progressiste incluant une (modeste) distribution des terres, un développement de l’éducation scolaire et un embryon de sécurité sociale. La classe politique iranienne se divise. Le Parlement élu soutient Mossadegh. Le Sénat, formé de membres de la cour, de notables et de grands propriétaires fonciers, tous nommés par le Shah, lui est hostile.
Bientôt, les effets des sanctions économiques se font sentir. Le pays entre en récession. Les divisions internes s’élargissent, les affrontements de rue se multiplient et Mossadegh, sentant le vent du complot, se raidit. Le 15 août 1953, le Shah d’Iran signe un « décret impérial » le destituant et le remplaçant par un général (nommé Zahedi) – décret dont Mossadegh conteste la constitutionnalité. Le lendemain, l’« opération Ajax », nom de code du coup d’État planifié par la CIA américaine et le MI6 britannique, démarre, coordonnée avec le Palais. Motif invoqué : empêcher l’Iran de basculer dans le camp soviétique. L’appel à l’aide de Mossadegh à la radio nationale – « Mort à tous les traîtres », s’écrie-t-il – ne lui sera d’aucun secours. L’armée iranienne s’est ralliée au coup d’État. Le 19 août, elle vient arrêter Mossadegh chez lui. Ses partisans défendent sa maison. Les forces de l’ordre tirent. On compte 200 morts et 300 blessés. Mossadegh s’enfuit, puis se livre cinq jours plus tard. Le 22 décembre 1953, un tribunal le condamne à la peine de mort. L’ordre est de retour. Magnanime, le Shah peut le gracier.
Un an plus tard, la nationalisation n’est pas formellement remise en cause, mais le pétrole iranien est à nouveau géré par un consortium international dominé à 80 % par des compagnies anglaises et américaines. Il faudra vingt-cinq ans pour que le président américain Jimmy Carter admette à mots couverts la part de son pays dans le coup d’État. Le 18 août 2013, soixante ans exactement après les faits, la CIA dévoilera des documents classifiés indiquant officiellement que « le coup d’État militaire qui a renversé Mossadegh et son cabinet de Front national a été mené sous la direction de la CIA ».
Ce putsch va rester dans les mémoires iraniennes comme une souillure indélébile sur l’image des Américains. D’autant que le Shah s’inscrit alors de manière ostensible dans le « camp occidental ». Tout à son projet de « modernisation générale » et de laïcisation de son pays, il raffermit son emprise en s’appuyant sur les milieux financiers et sur une police secrète – la Savak – dont les méthodes musclées pour réprimer toute opposition vont vite s’imposer comme un mode de gouvernement. La relation entre les États-Unis et le Shah, qui s’intronise « empereur » en 1967, devient consubstantielle à la monarchie. C’est d’autant plus important pour Washington que, du côté des principaux régimes arabes (notamment l’Égypte de Nasser), on s’appuie sur Moscou pour résister à Washington.
Le Shah, longtemps avant le régime des mollahs, imagine son pays comme un acteur majeur de sa région. En 1958, l’Iran devient, avec la Turquie et le Pakistan, un pilier de l’éphémère pacte de Bagdad, sorte d’OTAN oriental mis en place par les Anglo-Saxons. Les États-Unis arment et forment l’armée iranienne. En 1974, en plein choc pétrolier, Time désigne à son tour Mohammad Reza Pahlavi, vingt-trois ans après Mossadegh, « homme de l’année ».
Dans cette décennie 1970, les présidents républicains Richard Nixon et Gerald Ford signent des accords avec l’Iran lui permettant de maîtriser le cycle complet de l’atome. Ironie de l’histoire, des cadres de la Maison Blanche comme Dick Cheney et Donald Rumsfeld jouent alors un rôle majeur dans l’octroi des matériaux fissiles et des compétences permettant à l’Iran d’effectuer ses premières avancées nucléaires militaires. Trente ans plus tard, devenus respectivement vice-président et ministre de la Défense de George W. Bush, les mêmes verront dans l’accès de l’Iran à l’arme nucléaire la menace la plus significative pour l’humanité.
Un seul « hic » dans cette idylle américano-iranienne, c’est qu’avec l’affaire Mossadegh et l’évolution de l’Iran sous le Shah, les États-Unis réussissent à coaliser contre eux les trois composantes principales du spectre politique iranien : les nationalistes, pour des motifs de fierté patriotique, les progressistes, par anti-impérialisme, et les religieux, qui honnissent cette incarnation de la dépravation que symbolise à leurs yeux la société américaine. Mais les Américains restent aveugles à ces évolutions. Lorsque les masses iraniennes, en 1978, se soulèvent pour faire tomber le régime impérial, sur fond de récession économique, ce sont précisément ces foules constituées de nationalistes, de progressistes et de religieux qui descendent dans les rues pour dénoncer le Shah, sa police politique et les États-Unis, leur indéfectible soutien.
L’Amérique n’a rien vu venir. Le 1er janvier 1979, l’ayatollah Khomeyni descend de l’avion qui le ramène de Paris, après quinze ans d’exil forcé. C’est la tendance révolutionnaire islamique qu’il dirige qui l’emportera, balayant sans ménagement ses deux partenaires initiaux (et même une partie de sa propre mouvance, hostile à l’instauration d’une théocratie).
La République islamique est née. Et les Américains vont vite être confrontés à l’hostilité que lui vouent ses dirigeants. Les États-Unis sont désormais qualifiés par Téhéran de Grand Satan (le Petit Satan étant réservé à l’URSS et au communisme). Une affaire va contribuer à convaincre l’opinion iranienne que les États-Unis, pendant des années, ont aidé le régime du Shah à espionner, emprisonner et torturer les opposants. Le 4 novembre 1979, des centaines d’étudiants envahissent les locaux de l’ambassade des États-Unis. Paniqué, le personnel commence à détruire les documents diplomatiques. La rumeur se répand : les Américains effacent les preuves de leurs forfaits. Bientôt, le bâtiment est contrôlé par les étudiants : 52 Américains et 3 autres étrangers deviennent leurs otages.
Le régime exige, pour les libérer, que les États-Unis leur livrent le Shah, afin qu’il soit jugé. Le président américain Jimmy Carter refuse. La crise va durer près d’un an et demi. Les États-Unis imposent les premières sanctions économiques à l’Iran. En avril 1980, Carter rompt les relations de son pays avec Téhéran. Deux semaines plus tard, il lance une opération militaire destinée à libérer les otages. Elle se solde par un fiasco lamentable : quatre des huit hélicoptères américains se perdent dans le désert. Khomeyni va se venger en pesant sur l’élection présidentielle aux États-Unis, dont l’échéance est dans six mois. Il bloque toute négociation avec l’administration de Jimmy Carter pour favoriser le républicain Ronald Reagan. Celui-ci l’emporte facilement. Le 20 janvier 1981, il prononce son allocution d’investiture. Dix minutes après, les otages sont libérés.
L’affaire a contribué à la victoire de Reagan, mais elle a laissé un goût amer aux Américains. La nouvelle administration s’inquiète bientôt des velléités potentielles de la République islamique d’exporter sa révolution. Il faut l’en empêcher. Qui mieux que Saddam Hussein peut s’en charger ? Le dictateur irakien dirige un pays majoritairement peuplé de chiites (à 60 %), qu’il a allègrement massacrés autour de Bassora dans les années 1960. Il craint d’être la première cible de l’ambition régionale iranienne. De plus, il a lui-même des appétits territoriaux par rapport au Sud-Ouest iranien et entend devenir le maître du golfe Arabo-Persique. Pour couronner le tout, Saddam bénéficie du soutien diplomatique et militaire des États-Unis, de l’URSS (au début), de la France, de l’Allemagne et des monarchies du Golfe. Qui dit mieux ?
Le 20 août 1980, son aviation bombarde les aéroports iraniens sans préavis. Deux jours plus tard, son infanterie traverse la frontière. Comme tous les dictateurs en mal de gloire, Saddam croit en une victoire rapide : l’armée iranienne, après la révolution, semble très affaiblie. En réalité, la guerre de tranchées la plus épouvantable du xxe siècle depuis 1914-1918 commence. Elle va durer huit ans. Huit années de combats au corps à corps, une fois passé une phase initiale où l’Irak semble triompher aisément. La révolution iranienne envoie toute une jeunesse se faire décimer au front par dizaines de milliers pour empêcher l’avancée irakienne.
À partir de fin 1981, c’est l’armée de Saddam qui commence de reculer. Puis le front se stabilise. C’est Verdun. À partir de 1983, l’armée de Saddam Hussein utilise divers gaz (sarin, moutarde…) dans les affrontements. Isolée dans un environnement international hostile, la république des mollahs va tenir bon. Elle y parviendra grâce, entre autres, à une aide inattendue, venue… des Américains (avec un soutien israélien).
L’affaire est connue sous le surnom d’Irangate. Un groupe de « barbouzes » américaines de haut niveau, emmené par le colonel Oliver North, a mis au point un « coup tordu » peu commun. Pendant que les diplomates américains défendent publiquement l’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran instauré par leur pays depuis la crise des otages, les États-Unis livreront en secret des armes à Téhéran. La recette servira à financer des livraisons d’armes aux Contras, une milice armée qui, soutenue par la CIA, lutte au Nicaragua au renversement d’un gouvernement révolutionnaire, dit sandiniste.
Dans ce groupe, certains ne cachent pas la logique de ces livraisons : qu’Iraniens et Irakiens s’épuisent à s’étriper mutuellement ne peut que servir les intérêts américains. Si, en plus, on peut financer une contre-révolution dans un pays étranger (le Nicaragua) en la faisant payer par un pays tiers (l’Iran), l’affaire est juteuse. En 1985 et 1986, plusieurs milliers de missiles américains (entre autres) sont livrés à l’armée iranienne, d’abord via Israël, puis directement. Par ailleurs, ces ventes permettent de négocier la libération d’otages américains au Liban.
Le 3 novembre 1986, un haut cadre iranien des Gardiens de la révolution révèle le pot aux roses dans un entretien avec un hebdomadaire libanais. La presse américaine s’en empare. La Maison Blanche panique. Le président Reagan, dix jours plus tard, essaie d’éteindre l’incendie. Dans une allocution télévisée, il confirme très partiellement les faits et les justifie : « Mon but était d’envoyer un signal que les États-Unis étaient prêts à remplacer l’animosité [entre l’Irak et l’Iran] par une nouvelle relation. » Mais le scandale est trop fort. Reagan désigne une commission d’enquête. Le Congrès ouvre sa propre enquête.
Très vite, le constat est accablant : ce n’est pas un petit groupe de mercenaires qui a mené l’affaire, c’est directement la CIA. En plus du colonel North, une partie du gratin sécuritaire américain est impliquée, dont le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger, deux conseillers successifs à la sécurité nationale (Robert McFarlane et John Poindexter). Onze personnes seront condamnées, toutes graciées ensuite par le futur président George Bush (père). Ronald Reagan est parvenu à éviter de sombrer avec eux. Quand le cessez-le-feu est décrété entre l’Iran et l’Irak, le 20 août 1988, les deux pays sont exsangues. Leur guerre a fait, selon les estimations, entre 700 000 à 1,2 million de morts, aux deux tiers iraniens. Pour ces derniers, elle s’ajoute à une martyrologie qui, depuis l’affaire Mossadegh, voit les États-Unis se positionner chaque fois comme chef de file d’un Occident qui ne vise qu’à brider leur indépendance et leur souveraineté.
Treize ans plus tard, ce n’est pas George W. Bush qui les convaincra du contraire. Après les attentats d’Al-Qaïda, le 11 septembre 2001, le président américain et les « néoconservateurs » qui l’entourent inventent un concept, l’« axe du mal », qui, contre toute vraisemblance, réunit en un seul bloc les anciens ennemis : l’Iran islamiste chiite et l’Irak de Saddam Hussein avec le régime communiste délirant de Corée du Nord, tous possiblement liés à Al-Qaïda. Cet « axe » n’existe que dans la tête de ses concepteurs (l’Iran a tacitement coopéré avec l’armée américaine pour lui permettre d’envahir l’Afghanistan afin d’en expulser les membres d’Al-Qaïda). Mais il s’inscrit dans une ambition primaire : justifier une invasion militaire de l’Irak. Et il permet de fabriquer une « menace existentielle », les trois États, selon l’administration américaine, planifiant d’accéder à l’arme nucléaire dans un court délai.
La vie de ce concept durera le temps que l’invasion de l’Irak se transforme pour les Américains en fiasco politique et militaire. Pis : le seul vainqueur de cette guerre américaine est… la République islamique d’Iran, qui fait de l’Irak son arrière-cour, où les partis chiites, ses alliés, s’emparent du pouvoir. Un succès que les Américains ne peuvent endiguer.
En 2008, Barack Obama se fait élire en promettant de mettre un terme à l’occupation américaine de l’Irak. Tournant le dos à l’ineptie de l’« axe du mal », il récuse aussi le concept indifférencié de « guerre au terrorisme », pour revenir au Moyen-Orient à une stratégie plus traditionnelle, fondée sur trois constats majeurs : le premier est que cette région tient une place de moins en moins importante dans le concert international, caractérisé notamment par une montée en puissance de la Chine ; le deuxième est que lesdits « régimes arabes » sont dans un état avancé de déliquescence ; le dernier, que la stabilité de la région ne se fera pas sans admettre que l’Iran y est une puissance incontournable – et une puissance « rationnelle ».
Entre autres sujets brûlants qu’Obama trouve en entrant dans le Bureau ovale, il y a le nucléaire iranien. Depuis 2003, alertés par les Israéliens, les Américains assurent que l’Iran progresse à pas de géant vers l’obtention de l’arme nucléaire. L’Iran nie vouloir fabriquer la bombe A, mais revendique implicitement son droit à en détenir la compétence. En 2006, un groupe réunissant les 5 membres permanents du Conseil de sécurité (États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France) auxquels s’ajoute l’Allemagne – d’où son surnom de « 5 + 1 » – engage des négociations avec Téhéran. Elles échoueront, Iran et États-Unis se rejetant la responsabilité de l’échec.
Obama, au pouvoir, les relance et engage son pays dans des pourparlers secrets avec Téhéran. Le 14 juillet 2015, le JCPoA (Joint Comprehenive Plan of Action, ou Plan d’action globale commun) est signé par les 5 + 1 et l’Iran. Téhéran s’engage à limiter sa détention de matière fissile, à ouvrir en totalité ses sites nucléaires aux inspecteurs internationaux et les Occidentaux à lever graduellement leurs sanctions économiques. Pratiquement, cet accord garantit au moins sur dix ans qu’il faudrait aux Iraniens au minimum une année pour se trouver en capacité de fabriquer une bombe atomique s’ils contrevenaient à l’accord – laissant aux Occidentaux ce laps de temps pour les en empêcher.
À la République islamique, cet accord offre l’espoir d’accéder à son souhait le plus ardent : être reconnue comme légitime par la communauté internationale. Le JCPoA fait force de loi internationale après son inscription dans deux résolutions unanimement votées par le Conseil de sécurité.
On connaît la suite. Le 20 janvier 2018, Donald Trump entre à la Maison Blanche. Le 8 mai, il annonce que les États-Unis se retirent d’un accord qu’il juge « défectueux à la base ». Et il lance contre l’Iran des sanctions économiques d’une dimension inédite. Celles-ci participent à appauvrir grandement la population du pays et à générer des mobilisations sociales. Mais elles ne suffisent pas à empêcher la République islamique d’élargir son assise régionale. L’Iran joue un rôle majeur dans la préservation du régime d’Assad en Syrie. Il pèse lourd dans la politique de son voisin irakien. Il dispose au Liban, en Palestine, au Yémen et ailleurs au Moyen-Orient d’un réseau face auquel les États-Unis semblent impuissants.
Le 14 septembre 2019, des missiles s’abattent sur deux raffineries de l’Aramco en Arabie saoudite. L’attaque est revendiquée par les Houthis, alliés yéménites de Téhéran. Elle est suivie d’attaques contre des pétroliers occidentaux dans le Golfe. Le message est transparent : si l’Iran ne peut pas exporter son pétrole, alors un jour personne d’autre ne le pourra.
Le 2 janvier, un missile américain tue le général iranien Qassem Soleimani, en visite en Irak. Celui-ci est plus qu’un militaire ; il est, pour beaucoup d’observateurs, l’homme le plus fort d’Iran après son « guide spirituel » Ali Khamenei. Une semaine plus tard, Donald Trump déclare : « Depuis trop longtemps, depuis 1979 pour être précis, les nations ont toléré le comportement destructeur et déstabilisateur de l’Iran au Moyen-Orient et au-delà. Ces jours-là sont finis. » Ainsi, pour l’actuelle administration américaine, tous ses prédécesseurs à la présidence ont été « laxistes » vis-à-vis de la République islamique. L’Iran en incarnation du Malin, cette vision domine l’état d’esprit de Washington et d’une partie notoire de son opinion publique conservatrice. Avec l’assassinat de Soleimani, nul doute que les États-Unis font plus que jamais figure, à Téhéran, de « Grand Satan ».
« Téhéran fera tout pour polluer la campagne de Trump »
Michel Foucher
Quelle est la conséquence politique du crash de l’avion ukrainien touché par un missile iranien ?
Le principal effet a été de briser le consensus autour de la figure du g&e…
[Numérologie]
Robert Solé
Sur Twitter, Donald Trump a menacé de bombarder « 52 sites de très haut niveau, très importants pour l’Iran et pour la culture iranienne » si les États-Unis sont à nouveau pris à partie par la R&eacu…
« Je vous avoue mes méfaits… »
Fariba Adelkhah
Son procès est un coup fatal porté au climat de confiance et de quiétude indispensable à la recherche. C’est non seulement une atteinte au peuple et à ses élites, mais aussi un aveu de faiblesse du régime. À mon tour, Mo…