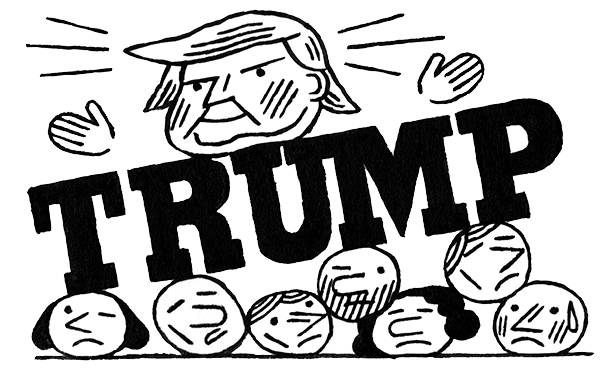Portrait d’un mégalo narcissique
Dès 1973, le nom de Donald Trump fait la une du New York Times. Avec ce titre : « Un important propriétaire immobilier est accusé de partialité contre les Noirs. » Scandales, outrances, faillites, démentis cinglants : ainsi commence la vie publique du nouveau président américain. Dans un portrait fouillé, Sylvain Cypel, spécialiste des États-Unis, dresse le profil psychologique, moral et politique de ce milliardaire mégalomane saisi par la fièvre du pouvoir. Une vivante confirmation de la citation célèbre du grand écrivain Mark Twain qui conseillait afin de réussir en Amérique la recette suivante : « Beaucoup d’ignorance et beaucoup de confiance en soi. » Sylvain Cypel décrit le président comme « un briseur de codes fasciné par le culte de l’homme fort ». Formé par Roy Cohn, un avocat qui fit la chasse aux « communistes » aux côtés du sénateur d’extrême droite Joseph McCarthy, Trump avance tel un bulldozer. Plus amoral qu’immoral. Pour lui, écrit son portraitiste, « se conformer à la loi, c’est trouver sa faille ». Chez Trump, pas d’affect. Des chiffres. Voilà pourquoi l’une de ses phrases préférées est tirée du Parrain : « It’s not personal, it’s just business. »Temps de lecture : 23 minutes
« Je n’ai jamais constaté le moindre cas où, sous la pression, Trump choisit la modération. Au contraire. Il contre-attaque, provoque, argumente. L’homme ne sera pas différent s’il est élu président. » Ainsi s’exprimait sur la chaîne CNN l’auteur Michael D’Antonio trois mois avant l’élection de Donal Trump, auquel il a consacré deux ouvrages biographiques. Selon lui, l’approche spontanée du magnat, en situation de conflit, est systématiquement celle de la « rétorsion disproportionnée ». Dès qu’un antagonisme se fait jour, il revendique toujours la posture de l’agressé. Ensuite, sa réaction est volontairement sans proportion avec le coup supposément subi. En d’autres termes, il se conduit comme Don Corleone, le parrain du best-seller de Mario Puzo. Si l’interlocuteur ne se soumet pas, il tranche la tête de sa meilleure pouliche et la place encore sanguinolente dans son lit. Trump « part du principe que la disproportion est normale ».
« Je pense sincèrement que si Trump l’emporte et peut actionner les codes nucléaires, il existe une forte possibilité que cela entraîne la fin de la civilisation. » Ce verdict-là, c’est Tony Schwartz qui l’a énoncé. Schwartz fut le « nègre » de l’ouvrage le plus célèbre de Trump, The Art of the Deal (« L’art des affaires »). Pour rédiger ce livre paru en 1987, il a passé dix-huit mois dans une grande proximité avec son sujet. Interrogé fin juillet par la célèbre enquêtrice du New Yorker, Jane Mayer, il brosse de Trump un portrait aussi terrifiant que celui de son biographe, évoquant un homme pour qui « le mensonge est une seconde nature ».
Schwartz dit aujourd’hui de ce livre : « J’ai mis du rouge à lèvres sur le groin d’un porc. » Traduction : il a, à l’époque, enjolivé un personnage qui, au fond, le révulsait. Il avait reçu une avance sur recette d’un demi-million de dollars. Mais lorsqu’il rentrait chez lui, après avoir passé la journée à suivre son commanditaire, il confiait à sa femme : « Ce type est un trou noir vivant. » Le livre fini, Schwartz dit avoir ressenti « un vide qui vous ronge de l’intérieur ». Il refusera d’écrire la « suite » que Trump lui demandait.
Un homme brutal, menteur, amoral, doublé d’une énigme – un « trou noir ». On dira qu’on force le trait. Pourtant, ces témoignages sont ceux de deux des très rares personnes indépendantes qui ont eu la possibilité d’approcher le magnat de très près sur de longues périodes. Et le rédacteur de ces lignes doit admettre que, plus il s’est plongé dans la documentation accessible, plus se renforçait chez lui la conviction que ce ne sont pas seulement les opinions professées par Trump qui révulsent, mais sa personnalité qui sidère.
Comment réussir en Amérique ? s’interrogeait l’écrivain Mark Twain en son temps. Sa recette – « beaucoup d’ignorance et beaucoup de confiance en soi » –, Trump l’incarne jusqu’à la caricature. Son ignorance du monde est abyssale et son narcissisme gargantuesque. En 1984, il explique au Washington Post qu’il saurait mieux que quiconque négocier les enjeux nucléaires avec l’URSS : « Ça me prendrait une heure et demie pour apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les missiles. De toute façon, je sais l’essentiel. » Peu importe la connaissance, lui saisit le monde par instinct. D’autant que, selon nombre de témoignages, il ne lit pas de livres. Et « il lui est impossible de garder son attention plus de quelques minutes sur quelque sujet que ce soit, hormis l’agrandissement de son propre ego. Et même ça n’est pas acquis », note Schwartz. Il n’a pas encore pris ses fonctions présidentielles qu’il annonce, contrairement à l’usage, qu’il n’entend pas commencer chaque journée par l’écoute du briefing des services de renseignement. Il n’a pas été élu pour s’ennuyer.
Pour cerner l’homme, le mieux est peut-être de commencer par le commencement. D’origine allemande, son grand-père fera son chemin à la fin du XIXe siècle dans la gestion de saloons et de maisons closes, en particulier dans le Yukon canadien et en Alaska. Son père, Fred, fera fortune à New York dans l’immobilier (déjà). Donald passe son adolescence dans une école militaire. Puis il étudie à Wharton, l’importante école de commerce de l’université de Pennsylvanie. Entré dans la vie active par un échec révélateur de son attrait pour le monde du spectacle – la comédie musicale qu’il a produite à Broadway s’arrête rapidement –, il poursuit bientôt les deux traditions familiales : l’immobilier et les casinos, modernes cousins des saloons d’antan.
Quand en 1971, à l’âge de 25 ans, « le Donald », comme le surnomment les Américains, prend la tête de l’entreprise familiale, il est un héritier fortuné. Son père dispose d’un patrimoine de 200 millions de dollars, l’équivalent de 1,23 milliard de dollars actuels. Son premier coup consistera à bâtir à New York un gratte-ciel de 58 étages pour lequel il a négocié avec le maire, Ed Koch, des conditions favorables hors normes. Qu’il le nomme Trump Tower n’est qu’un début. Narcisse boulimique, Trump donnera toute sa vie son nom à ses réalisations pour en faire une marque. Sous sa férule, l’entreprise paternelle devient « The Trump Organization ». Lorsqu’il acquiert une société de transport aérien, il l’appelle Trump Shuttle ; un yacht privé, c’est le Trump Princess.
Bientôt, il dépose son nom comme marque commerciale. Ses revenus augmentent à mesure que se multiplient les lieux – hôtels, golfs, etc. – dont les propriétaires usent de son patronyme contre paiement. La marque se décline aussi sur des alcools, des parfums, des matelas.... Son gendre Jared Kushner lui verse encore une redevance pour un complexe immobilier qu’il a lancé à Jersey City. Trump n’y a pas mis un sou, mais a autorisé Kushner à le baptiser Trump Bay Street.
Trump, écrit D’Antonio, est « le maître de l’autopromotion ». Il incarne pour son biographe la Me Generation, la « génération Ma Pomme ». D’où sa fascination pour les médias et un indéniable talent pour s’y mouvoir et les soumettre. Il n’est pas le seul, mais personne n’a su comme lui les utiliser pour mieux les vilipender. Il n’a pas seulement conçu, produit et animé une émission de téléréalité à succès durant quatorze saisons ; chaque matin, il démarre sa journée en lisant un rapport sur le nombre de fois où son nom a été cité dans les médias.
Sa notoriété, pourtant, avait commencé sous de douteux auspices. En 1973, pour la première fois, son nom apparaît à la une du New York Times. Titre de l’article : « Un important propriétaire immobilier est accusé de partialité contre les Noirs. » La justice le poursuit pour avoir ordonné que les Africains-Américains soient exclus de l’acquisition des appartements qu’il construit. Selon son principe, Trump « contre-attaque, argumente, provoque ». Il se proclame victime de « racisme anti-blanc » et exige 100 millions de dommages et intérêts pour propagation de fausses informations. Finalement, une fois le scandale éloigné, il passera un accord avec la justice et promettra de modifier sa politique immobilière pour éviter un procès. Cette attitude – brasser du vent, hurler au complot, avant de se replier une fois les lumières éteintes – sera l’une des marques de sa vie professionnelle. Comme resurgiront, de façon récurrente, les accusations de racisme et de machisme.
En 1984, il a suffisamment développé sa société pour se lancer dans un vaste projet : le développement d’hôtels-casinos à Atlantic City. À 200 kilomètres de New York, la ville est à Big Apple ce que Las Vegas est à Los Angeles : Sodome et Gomorrhe dans son arrière-cour. Trump y bâtira l’essentiel de sa fortune. Son hôtel-casino Taj Mahal, construit pour plus d’un milliard de dollars gagé aux deux tiers sur des obligations pourries, sera ouvert en 1990 et fera banqueroute un an plus tard. Des faillites, Trump en connaîtra six entre 1991 et 2009, toutes occasionnées par ses casinos. Chaque fois, il renégocie avec ses banquiers et ses investisseurs, qui préfèrent un arrangement à un effondrement. N’ayant mis que peu d’argent de sa poche, lui-même ne sera jamais mis en faillite personnelle. En 2011, il explique à Newsweek : « Je joue avec les lois sur les faillites. Elles sont bonnes pour moi. »
Cet aplomb, le Donald l’a acquis auprès de celui qui fut son véritable mentor dans les affaires et la politique. Il se nomme Roy Cohn. Dès les années 1940, il est l’avocat de son père Fred. Juriste en vue, Cohn défend aussi les intérêts de grands parrains – il sera l’avocat de John Gotti, le futur capo des Gambino, la plus importante famille de la mafia new-yorkaise. Au début des années 1950, Cohn met ses talents au service de Joseph McCarthy, ce sénateur d’extrême droite qui a lancé une immense chasse aux sorcières dans les milieux artistiques et intellectuels progressistes américains. C’est Cohn qui mena, pour McCarthy, l’interrogatoire de David Greenglass et l’amena à incriminer sa sœur, Ethel Rosenberg, d’espionnage au profit de l’URSS. Celle-ci, comme son mari Julius, fut condamnée à mort et exécutée. Greenglass, entre-temps, s’était rétracté. Mais son témoignage fut néanmoins validé par la cour. Pour l’amener à signer son « aveu », Roy Cohn avait usé d’intimidations inouïes.
C’est « sur les genoux de Cohn, le maître de la politique de la destruction personnelle » de l’adversaire, écrit Mark Danner dans la New York Review of Books, que Trump a débuté dans la vie active. Avec Cohn, le décor du parcours du Donald est planté. On y trouve la proximité avec les milieux interlopes, l’atmosphère politique fascisante et l’absence de scrupules comme arme de destruction massive. Cohn, homosexuel caché, mourra du sida en 1986. Trump avait coupé tout lien avec lui quand la maladie était apparue. « Donald pisse de la glace », dira son vieux mentor. C’est pourtant sous sa coupe qu’il avait commencé d’incarner les outrances qui accompagneront le dynamisme spéculatif du capitalisme financier triomphant, celui qui fait de l’enrichissement personnel la valeur suprême et rabaisse la droiture au rang d’instrument de propagande. Lorsqu’on fera remarquer au candidat Trump qu’il entend expulser 11 millions et demi de sans-papiers alors qu’il en a utilisé à foison sur ses chantiers de construction, il commencera par nier les faits puis rétorquera, en substance : Et pourquoi m’en serais-je privé ? Est-ce ma faute, si la loi est mal faite et si le marché du travail me l’a permis ? De même, soupçonné d’avoir trouvé un biais légal pour ne pas payer d’impôts durant dix-huit ans, il s’étonne : son rôle de capitaliste ne consiste-t-il pas à s’enrichir ?
Trump et ses sociétés ont été impliquées dans 3 500 affaires judiciaires en trente ans, a recensé le quotidien USA Today. Recourant à une armada d’avocats, l’homme d’affaires est procédurier à l’extrême. Ayant acquis une propriété à Mar-a-Lago, en Floride, il engage immédiatement trois actions contre l’aéroport voisin. Le bruit des avions le perturbe. Il cesse les poursuites quand le comté lui propose un lot voisin de 87 hectares où il pourra aménager un golf luxueux.
Il est, aussi, peu regardant sur les moyens de s’enrichir. De 2005 à 2010, le Trump Entrepreneur Institute fera payer de 1 500 à 35 000 dollars des formations en gestion de biens immobiliers. Les cours sont bidon. En 2013, l’État de New York l’attaque pour fraude. Deux plaintes en nom collectif sont déposées contre lui. Comme d’habitude, il nie, provoque, contre-attaque. Le juge se nomme Gonzalo Curiel. Immédiatement, Trump l’accuse de partialité, vu son origine mexicaine. Comme souvent, l’affaire se clôt (dix jours après son élection) par un compromis classique : il versera 25 millions aux plaignants, lesquels assurent en contrepartie que Trump n’a commis aucune fraude…
On entre là dans un domaine que ses biographes décrivent à foison : Trump n’est pas immoral, il est amoral. S’il trouve une faille dans la loi, il s’y engouffre en toute bonne conscience. Businessman, son but est de gagner de l’argent. Pour quel motif s’imposerait-il des limites ? En Amérique, ce discours ressort du domaine courant des affaires. Après la crise financière de 2008-2010, chaque fois qu’un grand patron, celui de Goldman Sachs, d’Apple ou un autre, a été « cuisiné » par une commission du Congrès, tous, flanqués de leurs avocats, ont systématiquement répondu : « Je n’ai jamais enfreint la loi. » Vrai ! L’activité des 35 000 lobbyistes enregistrés au Congrès consiste en grande partie à ouvrir des failles et faire inscrire des exceptions dans les lois votées par les parlementaires.
Trump, au fond, a toujours suivi ce précepte : se conformer à la loi, c’est trouver sa faille. C’est commun dans son milieu. Mais contrairement aux autres, il l’a fait en s’en vantant. Est-il plus amoral que tous ces banquiers qui, durant la crise, ont vendu à leurs clients les produits financiers dont eux-mêmes se débarrassaient, sachant que leur cours allait s’effondrer ? Ou qu’Apple, champion de l’optimisation fiscale, aux gains faramineux, qui ne paie quasiment pas d’impôts ? Il ne le croit pas. Il croit qu’ils ont bien raison, et lui aussi. Il joue à un jeu où le plus fort ou le plus malin l’emporte, et il est sûr d’être plus malin que les autres. La preuve ? Il gagne souvent.
L’une de ses phrases préférées est tirée du Parrain : « It’s not personal, it’s just business. » Dans le roman, elle est prononcée par un ami historique du parrain qui vient de le trahir pour se vendre au clan adverse. Rien de personnel, c’était juste pour le business. Manière de dire que le business ne connaît ni affect ni morale. D’ailleurs, il faudrait être idiot pour croire sur parole chaque mot que Trump prononce : ses propos n’engagent que ceux qui y croient. En campagne, il promet de lutter contre les financiers et managers de hedge funds, « ces gars qui font du pognon facile et s’en sortent toujours ». Élu, il s’entoure à la Maison Blanche de personnes issues des milieux de la spéculation et nomme au Trésor un ancien de Goldman Sachs. Des remarques ?
De là un rapport purement utilitariste à la politique. Comme il a vu son père et Roy Cohn le faire, il achète le personnel dont il a besoin. Quand il lance le chantier de sa Trump Tower, un cadre municipal lui refuse une réduction d’impôts. Il le menace. La déduction est finalement accordée. Le fonctionnaire sera remercié par son embauche quelques années plus tard dans l’empire Trump, raconte un autre de ses biographes, Wayne Barrett.
Trump a été tour à tour républicain, démocrate ou indépendant. Et il a donné de l’argent à tous, en particulier à une certaine… Hillary Clinton, lorsqu’elle se présentait au Sénat, en 2000. Interrogé sur le sujet lors du débat du 6 août 2015, il répond : « Je donne à tout le monde. Et devinez quoi ? Quand j’ai besoin de quelque chose deux ou trois ans après, je les appelle. Et ils sont là pour moi. » Chacun connaît cette pratique aux États-Unis. La différence, c’est que lui l’assume sans fard.
À son impudence revendiquée s’ajoutent quelques traits de caractère très personnels. D’abord, l’attrait pour le clinquant. « La classe, mais façon Marbella » – la station balnéaire andalouse ultrabranchée –, se moque le chroniqueur américain Michael Tomasky. Ensuite, la jouissance dans le conflit. Le 20 février 2016, après avoir remporté l’élection primaire en Caroline du Sud, il s’écrie : « C’est dur, c’est sale, c’est méchant, c’est vicieux. C’est magnifique ! » Enfin, il est binaire jusqu’à l’excès. Le monde se divise à ses yeux en deux : « Soit vous êtes un salaud de perdant, un menteur, etc., soit vous êtes le plus grand », note son premier biographe D’Antonio. Le mur qu’il fera construire le long de la frontière mexicaine sera « beau et impénétrable », la couverture maladie qui remplacera celle instaurée par Obama coûtera seulement « une fraction » du prix précédent, et lui ne fera pas que bombarder Daech, il bombardera « cette merde de Daech ».
Quant à son rapport à la vérité, Trump lui-même l’a défini dans The Art of the Deal : « Je joue sur les fantasmes des gens. Eux-mêmes ne peuvent pas toujours penser en grand, mais ils peuvent être très attirés par ceux qui le font. C’est pourquoi une petite hyperbole ne peut pas faire de mal. Les gens veulent croire en ce qui est le plus gros, le plus grand, le plus spectaculaire qui soit. J’appelle cela l’hyperbole véridique. C’est une forme très innocente d’exagération. Et très efficace de promotion. » Schwartz, le vrai rédacteur de l’ouvrage, dit aujourd’hui qu’il a écrit ce passage pour adoucir le thème du mensonge. Cette phrase, ajoute-t-il, est « une tromperie. L’hyperbole véridique est une contradiction dans les termes ». Mais Trump, dit-il, avait « adoré l’expression ». Car il est un personnage en constante représentation, dans une forme de tromperie réfléchie. Il a joué un rôle phare dans le mouvement des Birthers, qui accusait Obama de ne pas être né aux États-Unis. Une fois ce mensonge éventé, il a argué n’avoir fait que reprendre une accusation énoncée par Hillary Clinton en 2008. Qu’il s’agisse d’un nouveau mensonge ne l’émeut pas plus que le précédent. « Rien de personnel, c’est juste du business. »
Dès lors, la vérité laisse place à une hyperbole où l’opinion fait office de fait. Quand il s’avère qu’Hillary Clinton a obtenu 2,8 millions de voix de plus que lui lors de l’élection présidentielle, il rétorque que c’est parce que « 3 millions de personnes ont illégalement voté en sa faveur ». Il n’avance aucune preuve, il affirme et cela suffit. Finalement, Trump trouvera une autre parade. Il prétendra qu’il aurait parfaitement pu remporter le suffrage universel s’il l’avait seulement souhaité. Il n’aurait eu qu’« à mener sa campagne différemment ».
À l’heure de la post-vérité, faits et analyses complexes ont du mal à se frayer une place face aux réseaux sociaux où toutes les opinions se valent. Le mensonge n’existe plus, puisque chacun construit « sa » vérité. Lorsque douze femmes accusent Trump d’agressions sexuelles, il réplique qu’Hillary Clinton a rencontré secrètement des banquiers internationaux, qui sont ses amis proches et ses donateurs, pour planifier la destruction de la souveraineté américaine. L’hyperbole véridique est à l’œuvre.
En conséquence, il assimile les journalistes à l’incarnation du « politiquement correct » qu’il abhorre. Le politiquement correct, c’est ce qui interdirait à l’homme libre d’énoncer des idées xénophobes ou misogynes, de nier les évidences ou de défendre le droit de chacun à s’enrichir comme bon lui semble. Lorsque les journalistes listent ses mensonges, il accuse leur travail d’être « biaisé ». Lorsqu’ils le placent devant l’évidence du mensonge, il rétorque qu’ils ont « intentionnellement mal interprété ses propos ».
Enfin, et peut-être surtout, Trump apparaît comme un briseur de codes fasciné par le culte de l’homme fort. George Bush niait que le supplice de la baignoire soit une torture. Trump admet qu’il s’agit bien d’une torture, et ajoute que, lui, il est pour. Cet iconoclaste libère les passions négatives. Le racisme, la xénophobie, la misogynie comme l’agression sexuelle ou la fraude fiscale échappent brutalement à l’interdit social et moral. Mieux : en les disculpant, il les valorise.
Quant au culte du chef… Durant sa campagne, il a publié un ouvrage intitulé Pourquoi nous avons besoin d’un chef, pas d’un politicien. Le chroniqueur Tomasky résume ainsi sa pensée : « Je conclus sans arrêt de gros marchés avec les acteurs les plus coriaces de la haute finance. Ces gens sont d’abominables tueurs en col blanc, brutaux, le genre de personnes qui laissent du sang partout sur la table du conseil d’administration et se battent jusqu’au bout pour maximiser leurs gains. Et devinez quoi ? Voilà exactement le genre de négociateurs dont les États-Unis ont besoin, à la place des mauviettes de diplomates qu’Obama envoie partout dans le monde faire mumuse avec les gouvernements étrangers. » Bref, à ces mous de diplomates, Trump préfère les « durs », si possible galonnés. Eux sauront s’y prendre avec tous les méchants qu’affronte l’Amérique. « Ses partisans, écrit Tomasky, ont très envie d’un chef qui les rende capables de dompter l’OPEP, la Chine et l’Iran, comme si les relations internationales se géraient à la manière d’une téléréalité. »
Ainsi va l’homme qui, le 20 janvier, occupera le Bureau ovale, définira les nouvelles options des États-Unis et nommera 4 000 nouvelles têtes au sommet de l’État. Ses premières désignations donnent un aperçu de ce qu’il entend réaliser. Jamais une administration américaine n’a inclus autant de figures de la droite extrême. Objectif : frapper fort et vite pour renverser le cours pris sous Obama. Abolir sa réforme de l’assurance santé, déréguler de nouveau la finance, accroître les expulsions d’immigrés, extraire les États-Unis des accords de lutte contre le réchauffement climatique, restaurer la relation avec Vladimir Poutine, abolir les effets de l’accord nucléaire avec l’Iran et soutenir la droite coloniale israélienne figurent parmi ses priorités.
Tournant radical et pérenne ou régression temporaire ? Beaucoup d’Américains s’inquiètent des dégâts que l’administration Trump occasionnera pour leur pays et dans le monde. D’autres voient dans le fait que Trump est le président le plus âgé de l’histoire américaine une parabole d’un phénomène fondamental : une victoire conjoncturelle qui n’est qu’un chant du cygne de la vieille Amérique apeurée face à l’Amérique mondialisée émergente. « L’avènement de Trump est un désastre, sur le plan interne et externe. Mais il s’agit d’un recul conjoncturel qui ne remettra pas en cause la voie vers une plus grande diversité et mixité dans laquelle s’est engagée l’Amérique », pronostique le sociologue d’Harvard Orlando Patterson.
Ses adversaires évoquent d’ores et déjà la possibilité d’un impeachment, cette procédure de destitution du président qui amena Richard Nixon à démissionner, en août 1974, par peur d’en être la cible. Même si le processus est long et compliqué, les motifs, selon eux, ne manqueront pas, surtout ceux liés aux risques de conflit d’intérêts entre la fonction et les affaires privées du Donald. À ce jour, il récuse l’installation d’un organisme indépendant de gestion d’actifs (un blind trust) et souhaite confier à ses enfants la garde de ses avoirs, une position qu’il ne pourra tenir longtemps sans risque.
Dans la mouvance anti-Trump, la Californie mène la résistance. Ses autorités et la société civile ont commencé à se mobiliser pour protéger les immigrés. Symboliquement, un mouvement « sécessionniste » s’organise. Parmi ses partisans, une idée germe. Se retirer des États-Unis pour associer la Californie aux autres États côtiers, l’Oregon et l’État de Washington, ainsi qu’au… Canada, et former une nouvelle union. Ainsi se retrouveraient ensemble des populations très largement ouvertes à la venue des immigrés, aux évolutions sociétales contemporaines (droit à l’avortement, mariage gay ou législation stricte sur le port d’armes), mais aussi à l’instauration d’une assurance santé universelle. À eux quatre, ces États-là détiendraient l’équivalent de 37 % du PIB américain, soit une fois et demie la taille de l’économie allemande. Ils constitueraient la troisième puissance économique mondiale, à égalité avec le Japon.
Ce nouvel État américain tourné vers l’Asie n’est pas près de naître. Mais que l’idée soit dans l’air montre combien les États-Unis sont aujourd’hui coupés en deux. Et combien Trump incarne cette division devenue radicale.
Voici la liste des ouvrages cités dans notre portrait de Donald Trump :
Michael D’Antonio, The Truth About Trump (Thomas Dunne Books, 2015) et Never Enough. Donald Trump and the Pursuit of Success (Thomas Dunne Books, 2016)
Donald Trump, Trump for President. Why We Need a Leader, Not a Politician (Kindle edition, 2016) et, avec Tony Schwartz, The Art of the Deal (Ballantine Books, 1987)
Wayne Barrett, Trump, The Greatest Show on Earth (Regan Arts, 1991)
« M. Trump adore procéder par brutalités »
François Bujon de l’Estang
Une fois installé à la Maison Blanche, Donald Trump sera-t-il conduit à modérer ses excès ?
Un Trump modéré, c’est un oxymore. La modération n’est pas dans sa nature et ce n’est pas cette quali…
[Gazouillis]
Robert Solé
Les discours-fleuves à la Castro ne sont pas son genre. Donald Trump est plutôt un adepte de la concision, comme l’indique sa manie de Twitter. Tout au long de la campagne électorale, il a inondé le réseau social de petits textes acerbes, ironiques, pa…
In Trump we trust
Aude Lancelin
Ce qu’incarne Trump dans l’imaginaire des millions de laissés-pour-compte américains qui lui ont permis d’accéder à la présidence des États-Unis ne laisse pas de fasciner. Comment ce parvenu new-yorkais, aujourd’hui milliardaire, a…