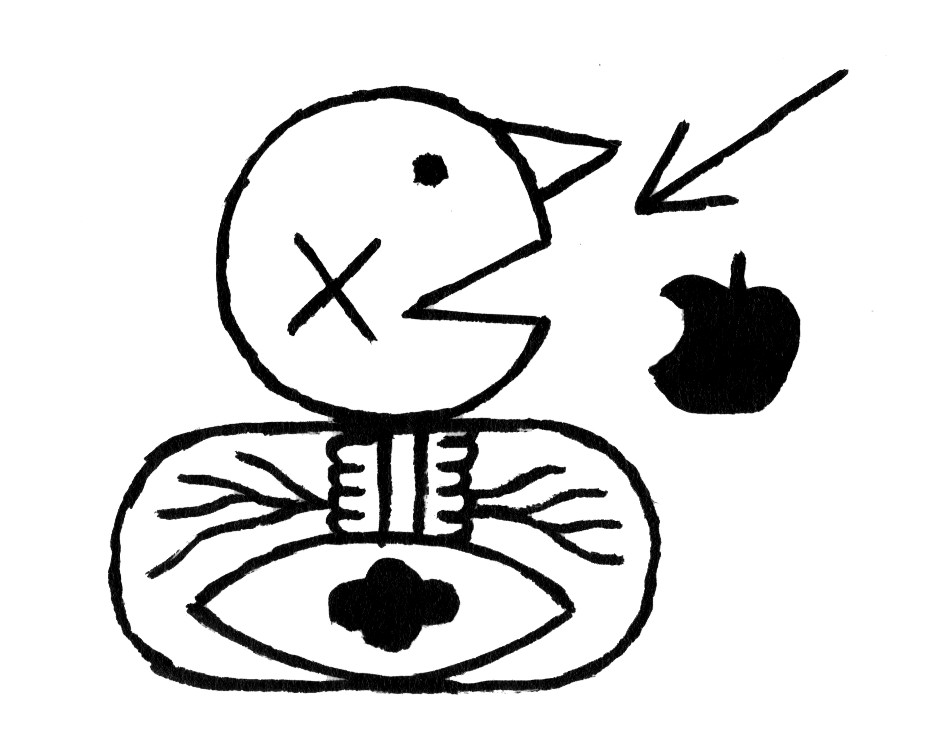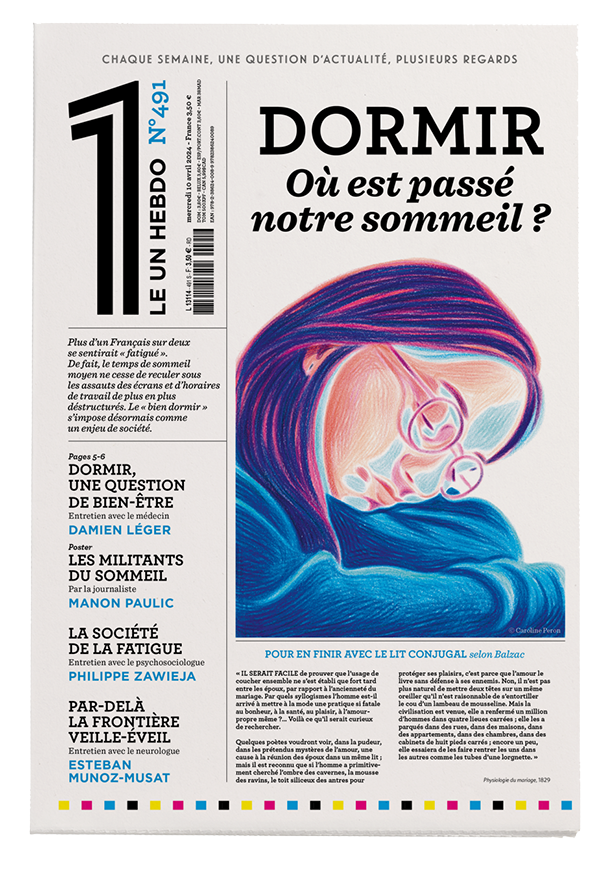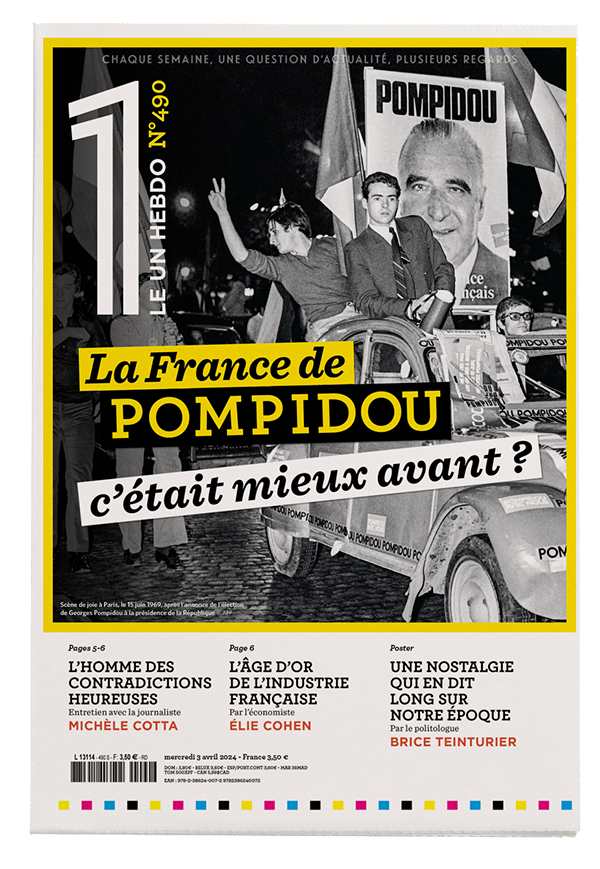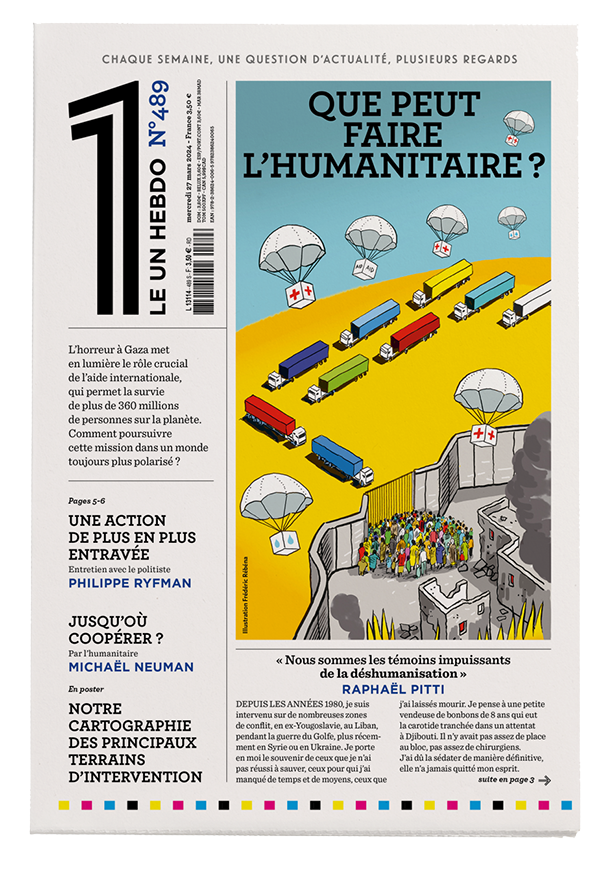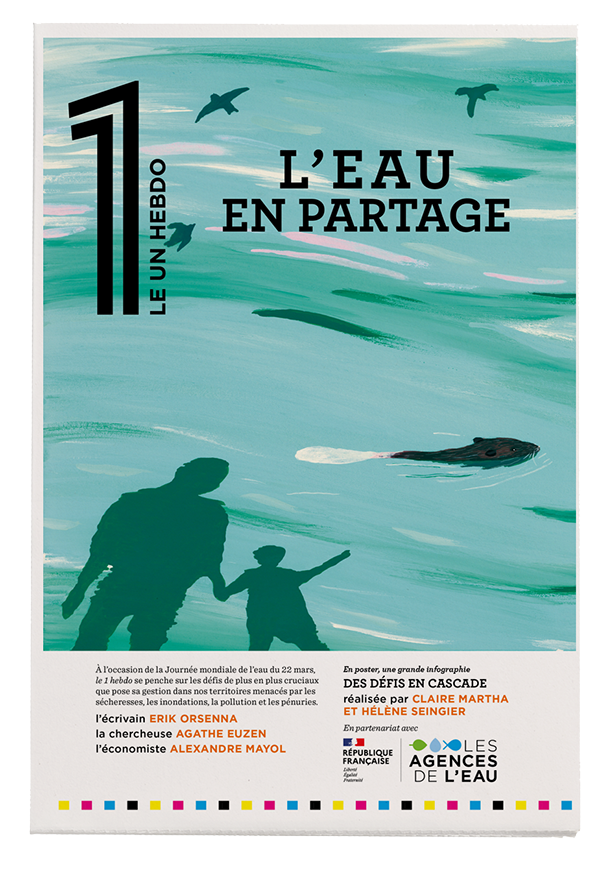Jeûner pour s’élever
Temps de lecture : 7 minutes
Dans nos sociétés d’abondance, la pratique du jeûne effraie. Se priver de nourriture, c’est entrer au pays du manque. Dans les contes de fées, il y a toujours, au grenier ou ailleurs, une porte interdite que l’héroïne ou le héros doit ouvrir. Elle représente la transgression. Derrière cette porte, le personnage doit affronter des épreuves qui vont le faire grandir. Dans le monde occidental où règne encore l’hyperconsommation et où nos habitudes alimentaires sont le fruit d’un travail de lobbying acharné de la part des industries agroalimentaires depuis un siècle et demi, jeûner est un acte transgressif.
Le jeûne a pourtant été pratiqué, et continue de l’être, par nombre d’êtres humains en quête de légèreté, pas seulement physique, mais aussi mentale. Si le jeûne implique une réduction drastique – moins de 250 calories par jour, l’équivalent d’une tisane et d’un bouillon –, voire une absence totale de nourriture extérieure, cela ne signifie pas que le corps cesse pour autant de s’alimenter. Les études scientifiques montrent que, pendant le jeûne, le corps inverse son mode de nutrition et commence à se nourrir sur ses propres réserves. Il puise principalement dans les lipides, ces graisses qu’il a stockées dans le passé, qui sont alors transformées en une sorte de sucre, principal carburant de notre corps, mais différent du glucose habituel. Ce sont les corps cétoniques. Le cerveau en raffole. D’où, au cours d’un jeûne, cette sensation de clairvoyance, de stimulation intellectuelle intense, voire d’élévation spirituelle.
En Occident, la privation de nourriture est vue d’un mauvais œil. À l’inverse, la nourriture est synonyme de réconfort, de partage, d’amour. Si elle est évidemment cruciale et vitale pour le corps humain, on sait désormais que s’en priver sur une période restreinte et sous conditions peut également se révéler tout à fait bénéfique.

La pratique du jeûne, bien qu’elle ait disparu pour des raisons principalement industrielles et capitalistiques, comme nombre de médecines populaires, remonte à l’aube de l’humanité. L’être humain a toujours été contraint d’alterner entre des périodes d’abondance et des périodes de disette. Et le corps humain a été dessiné par l’histoire de l’évolution, non pas pour vivre dans l’abondance, mais pour résister au manque. Dans le monde vivant, tout organisme est conçu pour bien vivre ces périodes de disette. Les manchots empereurs, qui sont de grands jeûneurs de la nature, peuvent cesser de s’alimenter sans danger pendant cent vingt jours. Leur épaisse couche de gras formée pendant la période d’abondance permet à leur organisme de résister au froid et de couver longtemps sans mettre leur vie en péril. Certains oiseaux migrateurs battent également des records. La barge rousse est capable de voler sur 11 500 kilomètres en huit jours pour parcourir un chemin allant de la Sibérie à la Nouvelle-Zélande, et cela sans avaler le moindre aliment.
L’être humain possède lui aussi cette aptitude oubliée. On trouve des traces de cette pratique dans l’Antiquité. Pythagore, par exemple, demandait à ses élèves de jeûner quarante jours avant de recevoir ses leçons. Le jeûne faisait office d’initiation vers une connaissance supérieure que représentaient pour lui les mathématiques, outil capable d’expliquer la structure de l’univers. Depuis, la médecine s’est développée et la biologie moléculaire est apparue. Par le biais de cette dernière, qui décrypte le fonctionnement des gènes, les scientifiques ont montré qu’en période de jeûne, l’expression des gènes change radicalement en 48 heures. Les cellules activent alors leur mode de protection, entrant dans une sorte d’hibernation pour consommer le moins d’énergie possible. Des modifications épigénétiques aussi rapides suggèrent, selon les chercheurs, que l’organisme obéit à une mémoire issue de l’histoire de l’évolution et que cette adaptation au manque est sans danger. Pour une durée déterminée.
Si la science a commencé à lever le voile sur les mécanismes fascinants du jeûne, des mystères sont encore à découvrir
La capacité à jeûner de chacun est calculée en fonction des kilos de lipides stockés. Des biologistes du CNRS de Strasbourg ont étudié la physiologie du jeûne et ont confirmé qu’en moyenne, un homme de 72 kilos en bonne santé est en mesure de jeûner sans se mettre en danger pendant quarante jours. Que l’on retrouve ce nombre dans les Évangiles n’est certainement pas un hasard. Et si au bout de quarante jours Jésus « eut faim » (Mt 4,2), c’est parce que l’organisme, atteignant la limite de ses réserves pendant le jeûne, envoie un signal qui pourrait se traduire par « alerte, danger ». C’est le signe qu’il faut absolument recommencer à se nourrir. Les manchots ont cette alerte, eux aussi. Ils quittent alors leur couvaison qui, généralement, touche à sa fin, et partent s’alimenter.
La plupart des religions – non seulement les religions révélées, mais aussi les religions chamaniques – ont ritualisé le jeûne parce que celui-ci nous permet d’échapper à notre condition humaine, physique et terrestre pour accéder à certains états différents. Il engendre un vrai sentiment de liberté, de bonheur, qui peut d’ailleurs s’avérer addictif. En faisant moi-même l’expérience du jeûne, j’ai mieux compris ce qui pouvait empêcher une personne anorexique de reprendre le chemin de l’alimentation. Portée par cette sensation de bien-être, par une énergie mentale et physique renouvelée, elle refuse d’y renoncer. Elle bascule alors dans une autre dimension, celle de la maladie. Les troubles du comportement alimentaires sont évidemment une contre-indication claire et nette à la pratique du jeûne. Mais tout jeûneur peut ressentir ce que l’on appelle le « syndrome du refus d’atterrissage ». Parce que le jeûne permet d’augmenter notre production de sérotonine et de dopamine, on se coupe des bruits et du fracas du monde. On passe en mode avion. Revenir sur terre peut sembler alors peu désirable.
Il est évidemment indispensable de rappeler que le jeûne est une pratique qui doit être absolument encadrée. Parce que les troubles du comportement alimentaires se développent généralement pendant l’adolescence, le jeûne n’est pas indiqué pour les plus jeunes. Les adultes doivent, quant à eux, le suivre dans un lieu adapté, avec supervision par un professionnel de santé. Un jeûne ne se commence jamais sans qu’une date de fin ait été fixée en fonction de l’état de son organisme, et il peut être contre-indiqué dans certains cas.
Le jeûne engendre un vrai sentiment de liberté, de bonheur, qui peut s’avérer addictif
Si la science a commencé à lever le voile sur les mécanismes fascinants du jeûne, des mystères sont encore à découvrir. Les Soviétiques avaient, en l’espace de quarante ans, étudié cette pratique sur des cohortes considérables de malades, mais l’Occident n’a jamais pris la peine de traduire cette somme de recherche, estimant que la biologie moléculaire avait, depuis, probablement rendu ces études obsolètes. Ces dernières n’ont pourtant jamais été menées chez nous ; or, on sait que les études cliniques sont irremplaçables. Parce qu’elles coûteraient très cher, elles ne seront certainement jamais réalisées chez nous. La recherche publique ne fonctionne quasiment plus aujourd’hui sans les financements du secteur privé, et je doute que les laboratoires pharmaceutiques aient un intérêt à participer à ces recherches-là, sachant qu’elles pourraient démontrer que l’on peut réduire nos besoins en médicaments.
L’hypertension est un cas classique : les hypertendus prennent une pilule tous les jours et à vie. Des expériences ont montré qu’en jeûnant plusieurs fois, des malades arrivaient à se passer totalement de ce traitement pour le reste de leur vie. Aux États-Unis, certaines assurances médicales remboursent les cures de jeûne pour les hypertendus depuis une dizaine d’années. L’impact du jeûne sur toutes les maladies chroniques, ainsi que sur les maladies psychiques, serait un champ aussi vaste qu’extraordinaire à étudier.
Le concept de légèreté est souvent relié au sentiment de se sentir jeune. Dans notre dernier documentaire scientifique, À la recherche de la jeunesse perdue (Arte, 2022), nous avons rencontré des biologistes du monde entier, et notamment dans les universités américaines Stanford et Yale, qui cherchent par tous les moyens à remonter l’horloge biologique. S’ils ont l’espoir de découvrir un jour, grâce à des outils technologiques toujours plus avancés, un équivalent d’élixir de jouvence, ils affirment qu’à l’heure actuelle, les méthodes dont on sait qu’elles sont efficaces pour rester jeune sont l’exercice physique… et le jeûne. L’une de leurs études a d’ailleurs montré qu’en jeûnant trois fois cinq jours en l’espace de six mois, l’âge biologique de notre organisme régressait d’un an et demi.
Je terminerai sur un point qui me semble important. Jeûner, c’est rétablir un dialogue trop souvent négligé avec son corps. Entrer en respiration avec lui, dans son rythme. Et comprendre mieux ses besoins réels. En même temps, on se met en rythme avec son environnement, avec la nature. En effet, dans un monde aux ressources limitées, jeûner, c’est passer un nouveau contrat avec notre planète. Établir un nouveau rapport, qui n’est plus basé sur la prédation. Et c’est le faire non pas contraint mais en toute conscience, joyeusement et librement. Donc en toute légèreté.
Propos recueillis par MANON PAULIC
« Il ne peut pas y avoir de légèreté sans travail »
Gilles Lipovetsky
Pour l'essayiste Gilles Lipovetsky, si notre époque se place sous le signe du léger, cela ne se traduit pas pour autant par un sentiment d’allégement de l’existence.
[Ambivalence]
Robert Solé
La légèreté a deux poids et deux mesures : elle peut renvoyer à la superficialité aussi bien qu’à la fluidité. Est-il logique qu’un même mot désigne d’absolus contraires ?
Joie de la volonté
Olivier Ponton
Pour Nietzsche, la légèreté est une aptitude, une force : la force de se charger du poids (c’est-à-dire de la valeur et du sens) de la vie, explique le philosophe Olivier Ponton.