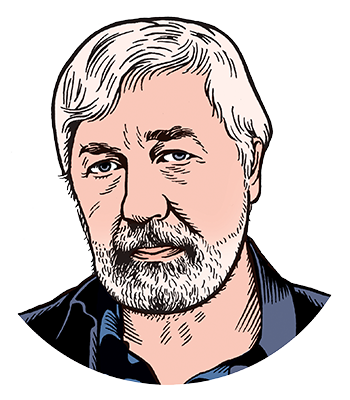Soldat et sentinelle
Temps de lecture : 5 minutes
Tout de suite, j’ai compris.
J’avais lu cette scène, je l’avais vue, d’autres me l’avaient racontée. J’ai reconnu cette qualité de silence. Ces rides soudaines sur le front du médecin, ses yeux plissés, cette manière de tenir la radiographie face à la fenêtre de son cabinet, jouant avec la lumière pâle de l’hiver.
J’ai su. Avant même qu’il ne prononce la phrase. Dans son regard revenu à moi, il n’y avait ni tristesse ni embarras. Seuls ses sourcils froncés disaient la gravité. Je ne respirais plus. Je savais qu’il me faudrait conserver ce souffle. Le garder au fond de moi, comme une arme de dernier recours. Un naufragé, prisonnier d’une coque de bateau retournée. J’allais devoir économiser mon air. Et aussi mes gestes, mes mots, ces petits riens qui font la vie.
– Il y a quelque chose.
C’était dit. Quelque chose, l’autre mot du cancer. Avant même que se mettent en place le protocole, les consignes, les guérisseurs, les tombereaux de médicaments, on repart avec ce sac de pierres.
Quelques jours plus tôt, ma femme m’avait appelé au téléphone. Un lundi, en fin de matinée. Elle était à l’hôpital pour une mammographie de routine.
– Il y a quelque chose, m’a-t-elle dit.
Sa voix blanche.
Je l’ai retrouvée dans une salle d’attente, le visage désert. Il y avait quelque chose, c’est-à-dire qu’il n’y avait plus rien. Nous étions à quelques jours des fêtes de fin d’année, les rues étaient bourdonnantes d’enfants, de lumières, de sapins à venir. Elle était entrée seule dans cet hôpital, pour une formalité. Mère pressée, entre un travail à finir et quelques derniers cadeaux à emballer. Elle en est ressortie, moi à ses côtés, un cancer au sein et les armes à la main.
– Je suis en guerre.
Ce furent ces mots. Des mots trop grands, en temps de paix. Pour elle, pour moi, plus rien ne ressemblait à rien. Les trottoirs encombrés de joie crasse, les étoiles dans les vitrines, les musiques d’enfance qui s’échappaient des boutiques. Quelques minutes plus tôt nous étions à la veille de Noël, une annonce plus tard, nous nous sommes retrouvés en décembre.
Ma femme avait changé. Ses gestes, son visage. Nous ne marchions plus dans la rue, nous montions au front. Et je serais son ordonnance. Je l’accompagnerais, j’ouvrirais la marche et la fermerais. Elle était en guerre, je le serais aussi. Vraiment. Il me fallait devenir soldat et sentinelle. Face à l’ennemi cancer, que son chargeur d’espoir soit toujours approvisionné.
Elle était en guerre, je le serais aussi. Vraiment
Après des années de reportage de guerre, j’avais écrit Le Quatrième Mur, sur les difficultés de revenir en paix. Pour enterrer un ami irlandais devenu traître aux siens, j’avais encore écrit. Et aussi pour interroger mon père, violent, cruel et follement égaré. La fiction, pour me détacher et revenir en douce, par le chemin des contrebandiers. Pour questionner autrement la mémoire. Pour entretenir une cicatrice. « Pour tourner la page ? » me demande-t-on parfois. Non, jamais. Je ne tourne pas les pages, je ne peux vivre que le livre grand ouvert. Ces pages, je les écris, je les relis et je les ajoute à d’autres.
Lorsque ma femme a employé le mot « guerre », une fois encore j’ai pensé à écrire. Qu’est-ce qu’on fait pour survivre à son minotaure lorsqu’on devient père soi-même ? Aux années de guerre à marcher dans du sang humain ? À la trahison d’un ami trop cher ? On fait ce que l’on peut. Pour le journaliste, qui s’interdit – à raison – la première personne du singulier au moment de témoigner ou de rendre compte, la fiction est un moyen de domestiquer le je. Peu importe si mes personnages ont des noms, des métiers, des vies de littérature. Je me cache derrière des masques de carnaval. Et le roman m’y autorise.
Pour cause de mère absente, les dames ont souvent manqué à mes romans. J’ai décidé que cette maladie m’autorisait à changer. Je serais narratrice. Avec l’accord et le soutien de ma femme, j’ai décidé de devenir Jeanne, libraire, atteinte d’un cancer du sein. Dans la vraie vie, j’ai accompagné ma combattante blessée, en chimio, en radio, dans des lieux souvent vides d’hommes. Maris absents, copains déserteurs. Mais mères, sœurs, amies pour le pire comme pour le meilleur. Et j’ai commencé à écrire. Avec difficulté. Non parce que j’étais femme, Jeanne, libraire – je revendique le droit de me battre sous n’importe quelle peau – mais parce que je n’étais pas malade. Que je n’hébergeais aucun ennemi en moi. Sans me réveiller le matin la peur au ventre et m’endormir le soir la colère aux poings, je ne me suis pas senti légitime.
Et puis, « il y a quelque chose », à mon tour. Avant d’être soigné, ce mal de garçon allait devoir attendre. Que le combat de ma femme soit gagné, que ses cheveux repoussent, que sa vie passe à autre chose. Ensuite seulement, j’ai pu écrire. Jeanne, ses copines, leur bataille. L’histoire de ces guerrières trahies par ceux qui partageaient leur lit. J’ai voulu un texte décalé : le braquage d’une joaillerie, par quatre sœurs de maladie lésées par une société d’hommes. Et c’est au fond de mon lit d’hôpital, les bras perfusés, prisonnier d’une poche d’urine, que j’ai trouvé le titre de ce roman. Une joie féroce. Cette mal élevée, cette harpie magnifique, cette terrible beauté qui égorge le cancer à coups de dent.
« Notre boîte à outils est pleine de promesses »
Frédéric Thomas
Spécialiste du cancer, Frédéric Thomas analyse la place qu’occupe cette maladie dans les mécanismes de l’évolution biologique et sur les facteurs qui favorisent son expansion dans nos sociétés.
[Orgone]
Robert Solé
Disciple dissident de Freud, Wilhelm Reich refusait de voir dans le cancer une tumeur maligne. Selon lui, elle résultait d’une perturbation de la fonction sexuelle.
Le patient au centre de sa guérison
Manon Paulic
Le modèle de l’Université des patients, fondée à la Pitié-Salpêtrière en 2009, fait des émules. Retour sur cette initiative pionnière et l’émergence de ce nouveau métier de patient-partenaire.