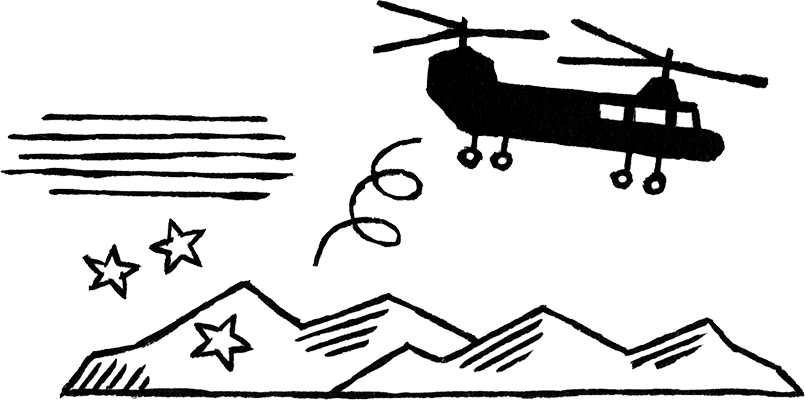« Nous avons changé le droit international en 24 heures chrono »
Temps de lecture : 8 minutes
Quelle était la qualité de la relation franco-américaine au moment où les États-Unis sont frappés par les attentats du 11-Septembre ?
Des relations au beau fixe. Pour vous en donner une idée, Jacques Chirac a appelé tous les jours Bill Clinton pendant la guerre au Kosovo (mars 1998-juin 1999). Et chaque jour, il lui disait : On m’informe que les avions de l’OTAN auraient reçu mission de bombarder la tour de la radio de Belgrade ou tel pont sur le Danube. Bill je te demande de donner instruction de ne pas le faire. Eh bien, il n’y a pas eu une cible que Chirac ait désignée qui ait été frappée par les avions de l’Otan. Cela situe l’intensité de la relation entre les deux présidents. Ils s’entendaient magnifiquement.
Et quand George W. Bush a succédé à Clinton ?
Une rencontre entre Jacques Chirac et George Bush était prévue à la Maison-Blanche fin septembre 2001. Et puis, il y a eu les attentats du 11-Septembre. Au fond, ce fut le premier test.
Où étiez-vous à ce moment-là ?
J’étais dans mon bureau, au 44e étage d’une tour qui avait une vue imprenable sur les tours jumelles du World Trade Center. Il faisait un temps magnifique et, à 8 h 30, le nez dans les dossiers du jour, je n’ai pas vu le premier avion s’encastrer dans la tour nord. Mais, levant les yeux, j’ai découvert l’immense nuage de fumée noire s’échappant des étages supérieurs. J’ai aussitôt appelé mes collaborateurs lorsque, quelques minutes plus tard, à 9 heures, nous avons vu un gros avion de ligne s’approcher et s’encastrer dans la tour sud. Notre réaction a été immédiate : L’Amérique est attaquée ! Elle est en guerre !
Comment avez-vous réagi ?
Il se trouve que la France assumait alors la présidence tournante du Conseil de sécurité. Nous devions être à la hauteur de l’événement, manifester notre solidarité avec les États-Unis et éviter que l’Amérique décide de s’engager seule et sans concertation dans une guerre contre son ennemi. Avec mes trois collaborateurs – Yves Doutriaux, Pascal Teixeira et Jean-Luc Florent –, nous avons rédigé en une heure un projet de résolution, et je suis allé à pied à la mission américaine pour parler avec son représentant. Je lui ai fait lire notre projet qui posait que la légitime défense collective pouvait s’exercer en réponse à l’attaque d’un groupe terroriste international. Il partageait notre crainte que l’Amérique s’engage seule dans ce combat. Nous avons obtenu que le Conseil de sécurité se réunisse dès le lendemain.
Cette résolution est-elle élaborée en étroite collaboration avec le Quai d’Orsay ?
Oui, mais là, toutes les communications internationales avaient été interrompues. Il n’était plus possible de parler avec Paris.
Et vous avez agi sans aucune directive ?
Exactement. Le 12 septembre, le Conseil de sécurité s’est réuni dans la grande salle. La Russie a demandé que le texte soit durci. Une heure plus tard, la résolution 1368 était adoptée ! Un record… Le lendemain, j’ai reçu un coup de fil du directeur des affaires juridiques du Quai d’Orsay qui me dit : Mais qu’avez-vous fait ? Vous êtes complètement fou ! Vous avez changé le droit international sans l’accord de Paris.
En quoi cette résolution changeait-elle le droit international ?
Le droit international ne connaît que les États. Nous introduisons la possibilité d’agir contre des groupes terroristes internationaux. J’étais assez mal… Nous avons changé le droit international en vingt-quatre heures chrono. Et à ce moment-là, Jacques Chirac m’appelle et me dit : Bravo Jean-David, c’est exactement ce qu’il fallait faire, je vous remercie de cette initiative. Et il enchaîne pour me dire qu’il veut être le premier chef d’État à venir à New York puis à Washington pour voir Bush, qu’il venait d’appeler pour l’assurer de tout son soutien et pour lui proposer de reporter leur rencontre étant donné la situation. Bush lui avait répondu : Au contraire, je veux que vous veniez pour souligner que l’Amérique n’est pas seule – exactement le même raisonnement que celui que nous faisions. Jacques Chirac a été le premier à se rendre à New York, le 18 septembre.
Aviez-vous compris immédiatement que l’Afghanistan et le groupe Al-Qaïda étaient impliqués ?
L’administration américaine en a réuni les preuves en vingt-quatre heures. Dès que la responsabilité de l’Afghanistan et d’Al-Qaïda a été établie, les États-Unis, soutenus par les Nations unies, ont demandé au gouvernement taliban de livrer les terroristes. Kaboul a refusé. Une réaction qui a paru hallucinante dans l’atmosphère du moment. Son refus a entraîné l’opération militaire qui trouve son terme aujourd’hui, vingt ans plus tard.
Quelqu’un dans vos équipes n’avait-il pas envisagé cet enlisement ?
Il faut se rappeler que cinq semaines après l’intervention de la coalition en Afghanistan, les talibans ont été chassés de Kaboul. Dans la confusion, Ben Laden est parvenu à passer entre les mailles du filet et à se réfugier au Pakistan. Le Pakistan a été le protecteur de tous ceux qui prêchent un islam très rigoriste. Cela explique pourquoi cette guerre en Afghanistan n’a jamais pu s’achever sur une victoire. C’est à cause du Pakistan, qui a fait semblant de coopérer.
Assez rapidement, Washington s’est focalisé sur l’Irak. Quand avez-vous compris cette obsession américaine ?
Nous le savions. Dès septembre 2002, Bush est venu parler devant l’Assemblée générale des Nations unies. Son message était clair : Il faut vraiment que vous vous occupiez de l’Irak parce qu’autrement nous nous en chargerons. C’était une menace : ou vous faites le job ou les États-Unis le feront seuls. J’en parle à Chirac et nous mettons en avant la nécessité d’en revenir aux résolutions du Conseil de sécurité, et donc de renvoyer en Irak des équipes d’inspecteurs afin de vérifier si, oui ou non, il existe en Irak des armes de destruction massive. À la fin des fins, nous sommes arrivés à un accord à l’unanimité avec la bénédiction des États-Unis. Chirac m’a félicité et nommé ambassadeur à Washington. Mais, en décembre 2002, je découvre un autre climat. Je présente mes lettres de créance à Bush. Il est très chaleureux et me dit en souriant : Maintenant, on va être ensemble pour la guerre en Irak. Je lui réponds : Monsieur le président, pas tout de suite ! Nous attendons les résultats de l’enquête des inspecteurs des Nations unies sur place. S’il y a refus de Saddam Hussein de permettre l’inspection de tel ou tel lieu, alors oui.
La position de la France est-elle alors très claire pour Bush ?
Bien sûr ! Bush me répond par un geste sans équivoque en émettant un pfff. Ce qui signifiait : Vous n’avez pas compris le film. Quand nous serons prêts, nous irons ! J’ai immédiatement envoyé un message à Jacques Chirac pour lui dire : On a un problème. Dès lors, on a regardé de très près ce que disaient les inspecteurs de l’ONU ! Or, ils ne trouvaient rien parce que Saddam, qui avait très peur d’une attaque, avait détruit tout ce qui aurait pu fournir un prétexte contre lui. J’ai découvert plus tard qu’à Washington, un nommé Ahmed Chalabi, dirigeant de l’opposition irakienne en exil, abreuvait les Américains d’informations, fausses bien entendu ! Il racontait à Wolfowitz, secrétaire adjoint à la Défense, que Saddam cachait des armes biologiques, bactériologiques et nucléaires. Tout était faux, mais les Américains prenaient ses propos au pied de la lettre parce que ça les arrangeait.
Aviez-vous la possibilité de manifester vos doutes, vos interrogations ?
Je passais mon temps à cela. Mais il y a une date clé : le 14 janvier 2003. Avec Maurice Gourdault-Montagne, conseiller diplomatique de Jacques Chirac, nous rencontrons Condoleezza Rice. Au cours de notre entretien, elle nous annonce que les États-Unis iront en Irak : Le président a pris sa décision. Maintenant, vous êtes avec nous ou contre nous. Ce jour-là, nous avons compris que la décision américaine était sans appel. Bush était complètement sous l’influence des néoconservateurs – Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz. Le malheureux Colin Powell, secrétaire d’État, était contre la guerre. Mais quand Bush lui a fait part de sa décision, au lieu de démissionner, il a répondu : « Yes, sir. » Et plus tard, il a défendu au Conseil de sécurité un point de vue qu’il ne partageait pas.
Pourquoi le fait-il ?
Parce que c’est un militaire. Le président ordonne, il se met au garde-à-vous.
Comment réagissez-vous ?
On s’est mis à bâtir une coalition au Conseil de sécurité pour empêcher la guerre. Les Américains faisaient pression sur les États membres non permanents du Conseil. Mais nous étions convaincus qu’ils ne possédaient que trois voix sûres : la leur, celles des Britanniques et de la Bulgarie. Finalement, ne parvenant pas à passer le seuil de neuf voix sur quinze, ils ont renoncé à présenter leur résolution. Et ils ont déclaré la guerre sans aval international.
Juste avant survient le discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité, hostile au déclenchement des hostilités, six jours après celui de Colin Powell.
Oui. Après la déclaration de Villepin, Powell m’a appelé pour que je passe le voir. Il m’a dit : Je ne peux plus vous aider. Je suis carbonisé ! Powell avait tout fait pour retarder l’entrée en guerre.
Que pouviez-vous faire ?
J’ai proposé à Jacques Chirac de publier un article d’opinion dans le New York Times, qui est paru. L’objectif était de dire à l’opinion américaine : Ne faites pas une guerre qui sera calamiteuse. Vous détruisez l’entente extraordinaire que nous avons bâtie ensemble après le 11-Septembre pour un ordre mondial meilleur, fondé sur le droit, la coopération de tous et l’acceptation que les États-Unis sont le leader du monde.
Jusqu’à l’entrée en guerre, j’ai passé des heures dans des débats aux États-Unis pour l’expliquer. Quand la guerre a éclaté, je me suis retrouvé à prêcher dans le désert.
Est-ce avec cette guerre que les États-Unis commencent à perdre leur position d’hyperpuissance ?
Bien sûr ! Reprenez la chronologie. Après la décomposition du bloc de l’Est communiste, les États-Unis se retrouvent seuls en position d’hyperpuissance. Commence une décennie prodigieuse où, pour l’Occident, tout baigne, sous la direction de Washington. Tout cela s’effondre le 11 septembre 2001. Le choc pour les Américains est inouï. Au pic de leur puissance, ils découvrent leur vulnérabilité. Cela les déstabilise complètement. Dès lors, les néoconservateurs s’imposent : haro sur l’Irak ! Leur guerre va vite tourner à la catastrophe. Les responsabilités de leurs dirigeants, et tout particulièrement de Donald Rumsfeld, sont évidentes. C’est le principal message de cette guerre. Les Américains y ont découvert que la seule hyperpuissance militaire ne règle pas les problèmes.
Propos recueillis par SYLVAIN CYPEL & LAURENT GREILSAMER
« Nous avons changé le droit international en 24 heures chrono »
Jean-David Levitte
L’image hallucinante des tours jumelles de New York frappées par les avions-missiles d’Al-Qaïda semblait indépassable dans la mise en scène froide et calculée de l’horreur. Mais de ce brasier humain saturé de métal, de verre et de cendre, d’autres images sont nées comme d’un ventre immonde, là où…
[Asymétrie]
Robert Solé
SELON le rapport officiel des autorités américaines, la préparation et l’exécution des attentats du 11-Septembre (cours de pilotage, notes d’hôtel, frais de déplacement…) ont coûté à Al-Qaïda près d’un demi-million de dollars.
Un statut pour les victimes de terrorisme
Jenny Raflik
À New York, les anciennes tours jumelles ont laissé la place à des bassins. Sur les parapets de bronze qui les ceinturent, 2 983 noms sont gravés, en neuf ensembles : les victimes de la tour nord, celles de la tour sud, les morts du Pentagone, les équipages et passagers des quat…