Cher Corbu…
Temps de lecture : 6 minutes
Comment traduire cette impression si singulière que vous me procurez ? Comment dire la séduction qui opère encore et la déception toujours présente ? Sans doute faut-il revenir à votre idée de Ville radieuse, ce projet d’une ville parfaitement réglée dont vous étiez le maître absolu. Ce projet que vous avez porté, cette vision personnelle que vous entendiez appliquer de manière autoritaire à la société, voilà probablement le socle du malaise et du malentendu.
Vous étiez déjà connu, célèbre en 1935, lors de votre voyage à New York et à Chicago, invité à expliquer aux élites américaines vos conceptions architecturales. Le directeur du New York Times était venu en personne vous accueillir en bas de la passerelle du paquebot. Mais vos conceptions trop systématiques comme la séparation des voitures et des piétons, des fonctions de la ville – endroits où l’on vit, endroits où l’on se fortifie en faisant du sport, etc. –, toute cette organisation urbaine ex nihilo, s’étaient heurtées à l’American way of life. Quel échec retentissant au terme du séjour !
Cher Corbu, vous vouliez réinventer l’individu et la ville. Greffer un homme nouveau dans une ville nouvelle. Lui dire tu feras ci et ça. Tu vivras là… Votre concept a fini par faire peur. Votre utopie grandiose est apparue pour ce qu’elle est : déraisonnable. L’une de ces utopies qui ne se réalisent jamais, sous-tendue par une démiurgie très directive et pesante.
J’ai voulu voir Chandigarh, votre rêve devenu réalité. L’Inde accédant à l’indépendance, Nehru a eu envie de manifester la modernité de son pays par la création d’une ville nouvelle. À votre stupéfaction, il vous a appelé. Qui pouvait bien commander une utopie ? Nehru ! Il vous a demandé de dessiner la capitale du Pendjab. Que faire, cher Corbu ? Votre Ville radieuse n’était qu’une somme de principes, de points de vue qu’il a bien fallu appliquer sur le terrain. Que reste-t-il de votre rêve aujourd’hui ? Le spectacle d’un territoire orthonormé, une suite de rectangles et de carrés dont la plupart ne sont pas construits. Dans cette trame, il n’y a aujourd’hui pratiquement pas d’habitants, la végétation a gagné, des arbres ont fini par pousser.
Comment dire l’impression de désastre ? Le temps a fusillé la Ville radieuse et devant ce squelette urbain, le désarroi s’insinue quand soudain surgit un bâtiment sublime. Alors se dresse le grand Le Corbusier : le plasticien, l’inventeur de formes, le poète. Celui qui dessine sa main, paume tendue, pouce vers la droite, l’index et le majeur liés, distincts de l’annulaire et de l’auriculaire également liés. La forme d’une colombe, le signe de paix absolu. Là, vous êtes magnifique. Votre sculpture, posée simplement sur un socle devant l’Assemblée nationale, avec l’Himalaya en arrière-plan, devient œuvre d’art. C’est le génie du petit rien qui change tout. Et l’idée s’impose, cher Corbu, qu’un grand artiste comme vous n’est pas forcément un grand architecte.
Vous avez pourtant inventé la ville des années 1950-1960 ! Cela paraît si loin. Qui oserait aujourd’hui prétendre, à lui tout seul, écrire un modèle de ville ? Nous avons compris que le territoire est une matrice complexe, un système. Nous avons conscience de la complexité du tissu urbain liée à la densification de la ville quand vous aviez toute l’Inde pour construire… Les choses ont changé. Ma génération a l’expérience de la finitude des choses. Les matières, l’air, l’espace, tout cela est limite. Notre travail s’exerce sur la limite. Il faut essayer de la repousser, d’aller au-delà mais la limite est toujours là. La fabrication de la ville s’inscrit dans ce cadre.
Réunir cinq ou dix architectes pour dessiner le Grand Paris, comme on l’a fait au départ, n’a pas grand sens. Cher Corbu, nous avons encore tellement à apprendre… Le grand projet a accouché d’un nouveau réseau ferré de transports publics sans provoquer d’enthousiasme. C’était mal parti. Et voilà qu’à partir de ces lignes de métro, de ces stations et des nouvelles gares prévues, on retrouve une énergie. Des quartiers surgissent. Un métabolisme précieux recrée du tissu urbain.
Telle est la grande leçon : la ville ne peut pas être uniforme. Elle est par définition inattendue, imprévisible, cher Corbu. Or vous êtes le porteur d’une ville prévisible, strictement conforme à votre idée. Voilà ce qui me tient à distance et nous différencie. La ville vit dans la transformation, se recrée perpétuellement, pour ne pas dire qu’elle se régénère. Elle se déploie sans cesse à partir de ce qu’elle est déjà. C’est son paradoxe : il n’est pas nécessaire de la démolir pour la refaire. Elle part toujours de son épaisseur historique. C’est pourquoi je souris lorsque je repense à votre plan pour Alger. Vous vouliez raser une partie de la ville pour créer, dans un geste superbe, un bâtiment offrant une façade de plusieurs kilomètres de long. De quoi couper le souffle… Alger a très raisonnablement refusé ce geste de déraison ! Vous aviez cédé, encore une fois, à votre vertige de la page blanche, à ce démon de l’utopie urbaine.
Vous aviez l’intuition, l’audace, le cran. Vous étiez le premier moderne à proposer une vision urbaine et architecturale liée. Voilà notre dette ! Nous avons tous quelque chose à vous rendre. Mais votre vision exclusive, simpliste, vous a aveuglé. Votre volonté de séparation, d’organisation géométrique, voire mathématique, vous a conduit à rêver d’une ville fonctionnelle, selon votre expression, dont je ne rêve nullement…
Cher Corbu, si tant de nos contemporains choisissent de vivre en ville aujourd’hui, c’est dans l’espoir d’y vivre mieux. Ce n’est pas seulement pour se loger. La ville propose une dimension supérieure. Elle est un lieu de jouissance. À votre ville fonctionnelle, laissez-moi préférer une ville jouisseuse.
Conversation avec LAURENT GREILSAMER et MANON PAULIC


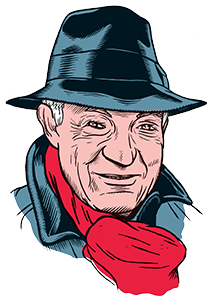
« Le Corbusier a triomphé pour le meilleur et pour le pire »
François Chaslin
On prête à Malraux la formule : « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. » Diriez-vous de la même manière que notre siècle sera urbain ou ne sera pas ?
C’est dé…
Agglomérations
Robert Solé
ARNAC-LA-POSTE : Bourg de la Haute-Vienne, injustement montré du doigt, alors que ses citoyens (Arnacois) ont toujours affranchi leur courrier selon le tarif en vigueur.
BANLIEUES : Communes suburbaines présentant de graves problèmes sociaux. Neuilly-s…
Une île à la pointe de l’écologie
Manon Paulic
Enveloppée dans une longue robe rouge, la jeune soliste aux boucles blondes fait face à la nef. Elle regarde en l’air, vers les voûtes, et accompagne de sa voix puissante les dernières notes qui émanent de l’orgue. Pour ce concert, la cathédral…







