Ce que nous apprennent les chasseurs-cueilleurs d’aujourd’hui
Temps de lecture : 5 minutes
Il y a deux types d’enjeux dans l’idée de croissance économique. L’un est démographique, comme une équation : nous sommes plus nombreux, il faut donc augmenter les ressources produites pour garder un niveau de vie constant pour chacun. L’autre renvoie à une conception spécifique des humains : ils seraient plongés dans un environnement relativement difficile, voire hostile, qu’il faudrait travailler pour parvenir à en arracher la subsistance de chacun.
Deuxième temps du raisonnement, qui suit ces prémisses, la vie se fonderait sur un naturel struggle for life, un combat pour la survie, inhérent à la condition des humains sur Terre, d’abord contre les animaux (songez aux dangers qu’affrontaient les hommes préhistoriques dans leur chasse au mammouth), ensuite entre les humains, en groupes ou individuellement.
Cette pensée a des prolongements en termes d’organisation politique, depuis le Léviathan de Hobbes, forme de souveraineté censée permettre le dépassement de la guerre de tous contre tous, jusqu’à la question de la régulation des appétits concurrents, qu’on la confie au marché ou à l’État – je reprends les termes les plus classiques de notre pensée de la gestion de cette donne concurrente entre les hommes.
Sans se demander si on est pour ou contre, on peut donc noter qu’à la croissance s’adjoint une sensation de nécessité pour la bonne entente sociale : si elle n’est pas au rendez-vous, le risque de voir le conflit reprendre pointe son nez, et le danger de la lutte collective, intestine, menace.
Tous ces raisonnements, liés à notre organisation sociale, sont généralisés, naturalisés, étendus à toute l’humanité comme si elle était, toujours, faite de cela. Un anthropologue qui recevrait à coup sûr un prix Nobel d’anthropologie s’il existait (avis aux nouveaux Nobel qui voudraient laisser une trace dans l’histoire), Marshall Sahlins, a décidé dans les années 1960 de prendre à bras le corps cette question de la subsistance comme mode économique initial. Les chasseurs-cueilleurs étaient-ils en constante lutte pour survivre, face aux éléments, face aux animaux, face au dénuement technologique qui était leur condition initiale ?
La réponse de Sahlins, scientifique, a été élaborée à partir de sociétés étudiées par des anthropologues : notamment les San du Kalahari (Bushmen), les Inuits, les Yaghan de la Terre de Feu, les Hadza de Tanzanie, ou encore des Aborigènes d’Australie. Il ne s’agit donc pas de sociétés préhistoriques, mais de sociétés de chasseurs-cueilleurs qui vivent actuellement sur la planète. Chez eux, pas de dénuement subi, pas de lutte perpétuelle pour survivre, pas de menaces constantes contre lesquelles il faut se défendre, pas de guerres intestines pour l’acquisition des subsistances. Au contraire, presque terme à terme : quelques heures de travail (entre trois et cinq en moyenne) par jour pour assurer la subsistance du groupe ; des mécanismes de détermination préalable des parts de chacun ; un environnement, ou plutôt un lieu de vie, perçu comme abondant, regorgeant de ressources, mais avec lequel il faut savoir traiter, à la fois en termes de respect et de connaissance ; enfin, des échanges éventuels avec d’autres groupes pour assurer une diversification des denrées et de bonnes relations.
Évidemment, je résume à gros traits, et une telle image réactive celle du bon sauvage, image aussi fausse que celle d’humains à la merci d’un environnement hostile. Guerres, prédation mutuelle, difficultés collectives, famines… les maux ne manquent dans aucune société : mais, encore une fois, une écoute attentive de ce qui existe permet de s’ouvrir l’esprit, de remettre en cause les évidences, de dépasser ce qui pourrait paraître normal, naturel.
Le mode de vie des chasseurs-cueilleurs n’est pas primitif, originel ou ancien, voire préhistorique. Il n’est pas meilleur ou moins bon que d’autres : il est limité objectivement dans le domaine de la production matérielle, mais il ne correspond pas à une pauvreté, chose qui induit une relation, un écart entre deux termes. Dans la mesure où la production est ajustée au besoin, Sahlins qualifie cette société de société d’abondance et, au fond, dit-il, c’est peut-être la seule, tant elle réduit à la plus grande simplicité l’organisation de l’oikos nomos (l’usage de la ressource, de l’avoir, de la propriété).
À la lumière de cet exemple, le débat sur la croissance interroge : plutôt que de savoir si elle est nécessaire ou non, il s’agit de mettre en perspective la pensée qui l’accompagne ; au-delà de la production matérielle continue et en augmentation, une reprise des questions d’organisation globale s’impose, non seulement entre les humains eux-mêmes, mais aussi avec tout ce qui les entoure. Par conséquent, pour finir, cet envoi : plutôt que la croissance, ne peut-on viser la grandeur ? Si les verbes croître et grandir semblent proches, les noms, croissance et grandeur, marquent l’écart entre les deux termes : croître comme une pousse, comme un donné sans fin, s’étendre et se répandre à la surface du globe terrestre ; ou bien grandir, être à l’écoute des potentiels des êtres, et trouver des réponses collectives appropriées à cette condition étrange qui consiste à peupler la Terre ?


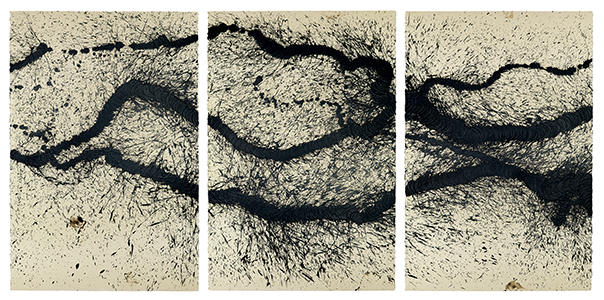
Croissance
Laurent Greilsamer
Tous affichés, mesurés, calibrés comme des produits de batteries. Serait-ce une obsession ? une religion ? Indiscutablement. Nous avons tous été un jour « en pleine croissance »…
Elle l'a
Ollivier Pourriol
– Tony Stark au supermarché, ça alors ! Iron Man fait lui-même ses courses ? Quel scoop !
– Qu’est-ce que je devrais dire ? Bruce Wayne en chair et en os, Batman au rayon jouets !
– Parle moins fort. C’est …







